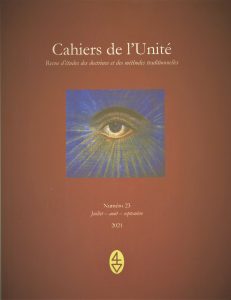Le culte de la vie : Que sont les Eaux?
Chapitre XX du livre d’Ananda K. Coomaraswamy : Yakṣas ; Essays in the Water Cosmology édité par Paul Schoeder. 1993.
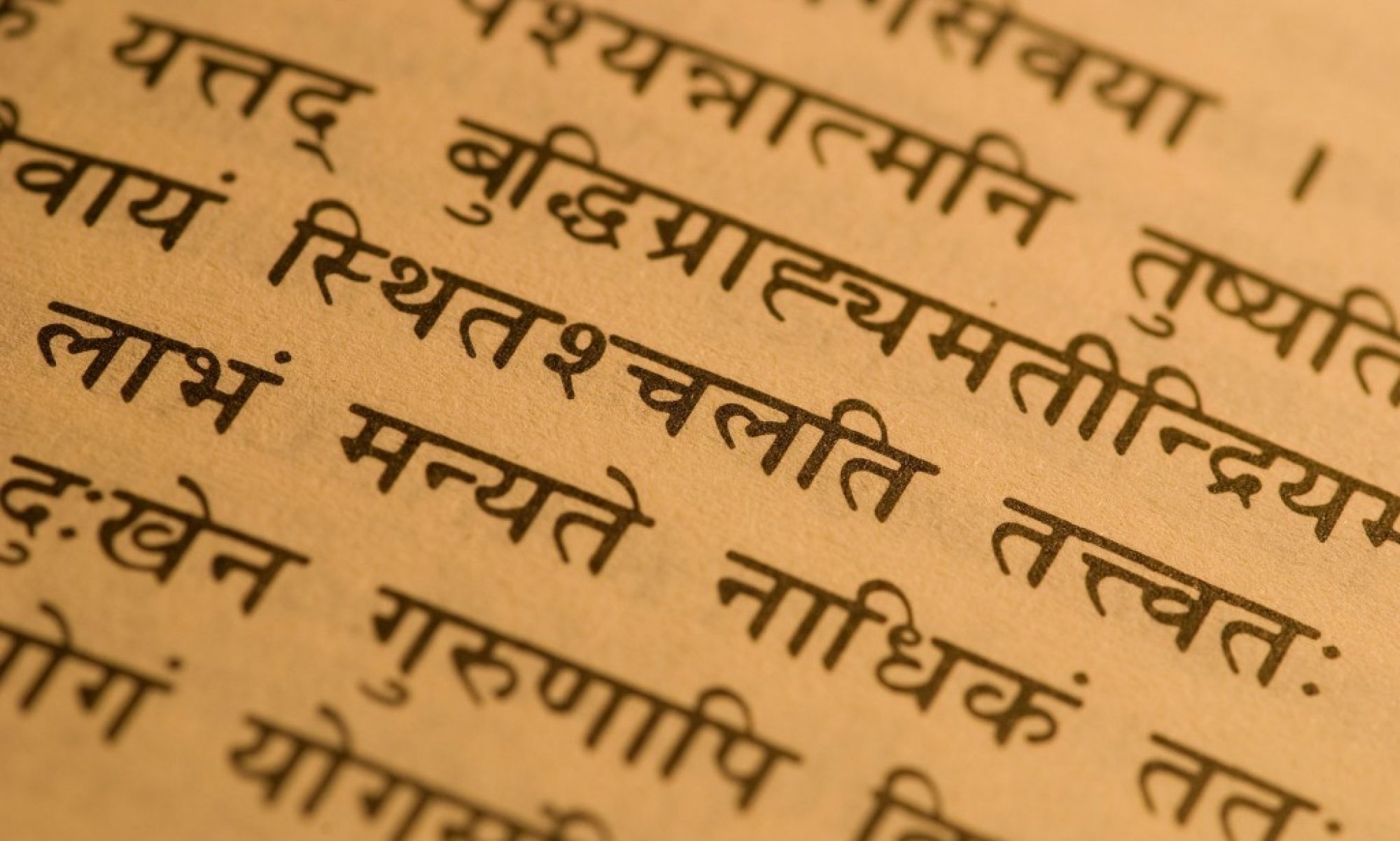
Par Max DARDEVET

Le culte de la vie : Que sont les Eaux?
Chapitre XX du livre d’Ananda K. Coomaraswamy : Yakṣas ; Essays in the Water Cosmology édité par Paul Schoeder. 1993.
Mahā-Pralaya et le Jugement Dernier
(Édité dans Cultural World, Los Angeles, III, 4, pp.14-16. Décembre 1932)

Continuer la lecture de « Ananda K. Coomaraswamy. Mahā-pralaya et le jugement dernier »
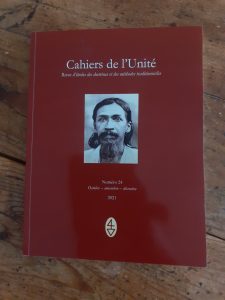
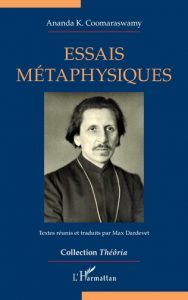
L’appréciation des arts non familiers
(Publié en 1936 dans The Visva-Bharati Quaterly)
Nous commencerons par faire deux suppositions implicites dans le début de cet exposé, à savoir (1) que, par choix ou par accident, nous avons devant nous quelque chose qui a été fait artistiquement, comme un tableau ou un vêtement d’un genre étrange, disons égyptien ou péruvien ; et (2) que le plaisir étant toujours préférable à la douleur, nous souhaitons si possible tirer quelque plaisir de la vue de l’objet qui se trouve devant nous.
Or, le plaisir est de deux sortes, soit des sens, soit de l’esprit, et comme nous voulons avoir le plus de plaisir possible, nous désirons les deux sortes. Les deux types de plaisir correspondent aux deux manières de considérer la « beauté » de l’objet. Le plaisir physique ou sensible peut lui-même être de deux sortes : direct ou imaginé. Si la valeur « décorative » de l’image ou la texture du vêtement nous plaît, le plaisir est direct ; mais si l’image est une représentation de quelqu’un ou de quelque chose qui nous est cher, ou si nous pensons que le vêtement réellement porté nous correspondrait, il sera indirect. De même, si l’image représente une activité qui correspond à nos goûts moraux ou à nos préjugés politiques. Si nous l’appelons « belle » en conséquence, nous voulons dire charmante, aimable ou sympathique, plutôt que belle au sens du philosophe.
D’un autre côté, ce n’est pas parce que l’objet et ses qualités ne nous sont pas familiers et qu’il peut nous sembler « barbare » ou du moins « bizarre , et parce que les œuvres ne représentent pas quelqu’un ou quelque chose qui nous est déjà proche, ni toujours des activités que nous pouvons approuver et parce que nous n’avons pas d’utilité immédiate pour cet objet, il y a de fortes chances que nous le trouvions laid, que nous ne l’aimions pas du tout, mais que nous le considérions comme une curiosité. C’est d’ailleurs dans cette optique que les musées ont vu le jour, en tant que collections de « curiosités ». Aujourd’hui encore, il arrive que des objets ayant valeur de « curiosité » soient offerts en cadeau à des musées « d’art », qui les refusent (au grand désarroi du donateur potentiel) et, d’autre part, les musées « d’art » (guidés par des experts) collectent et exposent comme des œuvres d’art de nombreux objets que le public « ne connaissant rien à l’art, mais sachant ce que je préfère » continue de considérer comme des curiosités – manquant ainsi les types de plaisir susmentionnés.
Il est donc évident que pour obtenir le plaisir désiré, nous devons apprendre à réagir à des beautés inconnues, à apprécier de nouvelles sensations et à approuver ou à autoriser des comportements chez d’autres personnes qui pourraient être inacceptables pour nous. C’est là l’un des prix à payer pour la culture ; juger de toutes choses uniquement en fonction d’un goût hérité, c’est précisément être « provincial ». En même temps, cela ne veut pas dire que nous devons devenir éclectiques, ou imitateurs d’œuvres inconnues ; il s’agit du contraire de la « culture ». Être « influencé » implique une incompréhension fondamentale de la signification du style et ne peut aboutir qu’à la caricature. Nous ne devons pas essayer de faire nous-mêmes ce qui est naturellement fait par les autres, mais plutôt faire preuve de patience et reconnaître que ce qui nous paraît d’abord étrange peut avoir été nécessaire et approprié dans son propre environnement, respecter les idiosyncrasies des autres tout autant que les nôtres.
La plupart de nos difficultés proviennent de la considération de choses arrachées à leur contexte. On peut facilement admettre, par exemple, que même la plus belle figure égyptienne ou chinoise d’une divinité aura un rapport incongru et, en ce sens, peu sympathique sur la cheminée d’un salon ou même dans un musée. Celui qui voit sa beauté ne la voit pas vraiment sur la cheminée, mais dans un environnement original mentalement reconstitué. Comme l’a si bien dit Goethe : « Celui qui veut comprendre l’artiste doit aller là où l’artiste a vécu et travaillé ». Si nous ne pouvons pas le faire littéralement (que ce soit dans les pays lointains ou les époques passées), nous pouvons le faire en esprit. C’est là que le professeur d’ « appréciation de l’art » et d’ « histoire de l’art » devrait nous aider et c’est principalement pour cela que nos guides et catalogues de musées devraient être rédigés.
C’est ainsi que nous pourrons devenir des « amoureux de l’art » et pas seulement des arts familiers, nous pourrons apprendre à admirer, à collectionner et à prendre plaisir aux objets mêmes qui nous ont peut-être un jour rebutés. Nous pouvons apprendre à apprécier leur raffinement ou leur charme, à reconnaître la sensibilité de l’artiste, l’élégance ou la vigueur de son goût, et à partager en partie ses goûts et ses dégoûts. Ainsi, nous devenons plus universellement humains et moins humains d’une manière purement personnelle. Cependant, tout cela reste encore une question de plaisir physique ou sensoriel, d’approbation ou de désapprobation morale. Ainsi, le goût a été éduqué et élargi, mais il reste un goût plutôt qu’une connaissance ou un jugement – nous ne jouons toujours que la moitié du jeu. Comme Platon l’a si bien dit à propos des simples amateurs d’art, « ils contemplent et aiment les sons et les couleurs, mais ils n’admettent pas que la beauté elle-même ait une existence réelle ». Il en va de même pour la majorité de ceux qui s’efforcent de se familiariser avec l’histoire de l’art, d’être capables de nommer, de reconnaître, de distinguer et de dater les différents types d’art, ce qui présente de nombreux avantages, mais peut parfaitement coïncider avec une indifférence presque totale à l’égard des œuvres d’art en tant que source immédiate de plaisir. C’est une chose d’en savoir beaucoup sur l’art, c’en est une autre de l’apprécier lorsqu’on le voit et d’être capable de juger de la qualité réelle d’une œuvre donnée. Pour participer au plaisir secondaire et intellectuel que procurent les œuvres d’art, il ne suffira pas alors de se forger un goût étendu et cultivé, ni d’être très savant en matière d’art, mais plutôt de bien comprendre sa raison, conformément à la définition suivante : « L’art est la véritable raison, ou manière, de faire les choses ».
Avant de considérer le plaisir secondaire ou mental que peut nous procurer la contemplation de l’objet inconnu, nous devons évoquer un obstacle qui se dresse sur notre chemin, celui du style ou du langage d’une œuvre d’art. Toute œuvre d’art a une signification qu’elle exprime, et ne doit pas être confondue avec ce à quoi l’œuvre peut ressembler, intentionnellement ou accidentellement. Pour prendre un cas extrême et concernant l’art des mots, supposons qu’un Chinois veuille dire la même chose que ce que nous souhaitons dire, il le dira en chinois, et nous en anglais. C’est en fait un axiome reconnu, que rien ne peut être connu ou exprimé autrement que d’une certaine façon. La manière chinoise sera intelligible pour les autres Chinois, mais pas immédiatement pour nous ; nous devons apprendre le chinois. Les difficultés ne sont pas aussi évidentes dans le cas des arts musicaux ou visuels. Mais elles sont néanmoins présentes. Il n’existe pas de langage absolument universel pour un art. Nous pouvons certes reconnaître qu’il y a des montagnes ou des rivières dans un paysage chinois et être intéressés ou non en conséquence, mais tout cela relève de la question du goût et de la connivence dont nous avons déjà parlé. Ce qui nous intéresse maintenant, c’est de savoir ce que l’artiste chinois entend par ses montagnes ou ses rivières, ce qui peut avoir ou non la même signification pour nous. Le fait est qu’il s’exprime d’une certaine façon, au moyen de ce que l’on appelle des « conventions », parfaitement intelligibles pour ses semblables, mais pas à première vue pas pour nous. Nous devons donc prendre la peine de nous familiariser avec le langage de l’artiste, afin de pouvoir le considérer comme acquis et de saisir son sens aussi facilement que ses semblables. Nous devons apprendre à prendre pour acquis des types de perspective inconnus et de nouveaux types de composition, afin de pouvoir comprendre sans s’arrêter à expliciter chaque symbole de son répertoire. En règle générale, nous aurons au moins ce grand avantage que, tandis que dans l’étude des œuvres des artistes modernes individuels, nous devons tout réapprendre pour chacun d’entre eux séparément, dans le cas de l’art chinois ou égyptien, la plus grande partie du vocabulaire, ou des conventions de l’art, est la propriété commune de toute l’école et demeure fondamentalement la même à travers de longues périodes de temps.
Nous avons parlé de « sens », mais non pas dans le sens populaire de ce que l’œuvre « parle » ou de ce qu’elle « aime » (ce qui appartient aux intérêts de l’association dont nous avons parlé au début), mais dans le sens de ce qu’elle signifie, de ce qu’elle a été faite pour et de ce qu’on attendait qu’elle fasse pour le spectateur ou, plutôt, de ce que celui-ci attendait qu’il puisse faire avec. Tout cela constitue ce qu’on appelle la cause finale de l’œuvre d’art, sa raison d’être. Cette cause est d’ailleurs l’occasion de ce que le philosophe entend par beauté de l’œuvre, à savoir l’expression claire de sa fonction, par laquelle elle nous invite à en faire usage.
Il est vrai que nous avons l’habitude, d’une part, de mépriser la signification du sujet dans une œuvre d’art et d’autre part, d’ignorer la signification – que ce soit dans la nature ou dans l’art. Nous devons cependant nous rendre compte que dans presque toutes les époques autres que la nôtre, tout a été considéré non seulement pour « ce qu’il est », mais aussi pour ce qu’il « signifie ». Par exemple, non seulement le ciel est bleu, mais « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Non pas d’une manière vague et sentimentale, mais d’une manière spécifique. Le lotus ou la rose n’est pas seulement une fleur charmante, mais représente naturellement le « fondement de l’être ». Nous arrivons ainsi à l’un des aspects les plus caractéristiques des arts méconnus, à savoir leur symbolisme, ou iconographie, comme on l’appelle lorsqu’il s’agit d’images ou de divinités. Ce symbolisme ou cette iconographie est alors l’expression de leur but et le véhicule immédiat de leur beauté – laquelle beauté, dans le sens de la philosophie, a à voir, non pas avec le sentiment, mais avec la connaissance.
Nous approchons enfin des sources du second type de plaisir, intellectuel, que l’on peut éprouver devant une œuvre inconnue, un plaisir beaucoup plus vif que le précédent, et qui peut être ressenti indépendamment du fait que l’œuvre elle-même soit ou non à notre goût. Le plaisir intellectuel sera double : d’abord, nous comprendrons ce qui est dit, ce qui est un plaisir plus grand que celui d’entendre simplement les tons doux de la voix de l’orateur et, en second lieu, nous jouirons du plaisir intense du jugement qui a été appelé « la perfection de l’art ».
Il est évident que nous ne pourrions jouir de ces plaisirs de comprendre ce qui est dit et d’avoir la capacité de juger si c’est bien dit ou non si nous ne savions pas ce qu’il y avait à dire, c’est-à-dire à quoi servait l’œuvre d’art et ce que le mécène avait l’intention d’en faire lorsqu’il a passé commande à l’artiste, dont la seule tâche était de bien réaliser l’œuvre qui lui était confiée. Même si l’artiste construit sa propre maison, et qu’il est donc à la fois mécène et artiste, le principe reste le même. La qualité du pudding se mesure à sa dégustation. Nous ne pouvons pas savoir si c’est une bonne maison sans connaître les fonctions particulières qu’elle doit remplir, le nombre de personnes qui vont y vivre, etc. Si elle ne remplit pas ces conditions, elle sera dépourvue de beauté formelle et ne pourra être qu’une œuvre d’art sans rapport avec la vie, et donc totalement inutile. De même, nous ne pouvons pas savoir si une icône quelconque, représentant la Madone ou Zeus, est « bonne » sans connaître l’idée de « Madone » ou de « Zeus » que le mécène a confié à l’artiste pour qu’il l’incarne dans la peinture ou la pierre. Ainsi, il arrivera souvent que l’homme qui va vivre dans la maison ou utiliser l’icône dans ses dévotions réelles sera un meilleur juge de l’art que l’esthéticien, dont la connaissance de l’objet est nécessairement accidentelle et analytique.
Les difficultés qui s’opposent à ces plaisirs intellectuels ne sont pas non plus aussi grandes qu’on pourrait le croire. La nature humaine elle-même fournit une base essentielle de consensus sur les principes fondamentaux, une fois que nous avons compris que nos propres préjugés et nos propres goûts ne sont qu’une partie de ceux des autres. Les saveurs peuvent différer dans le détail, mais ce sur quoi les préférences diffèrent reste le même…. Même les idées à exprimer et les symboles par lesquels elles sont exprimées sont amplement plus similaires que nous le supposons – les symboles sont en effet plus proches d’un langage universel et plus proches d’être les mêmes dans le monde entier que tout autre élément de l’art auquel nous avons fait référence. Ainsi, finalement, les différences mêmes qui, au début, empêchaient la compréhension deviennent le moyen de se connaître mutuellement et d’être attiré par les beautés spécifiques de l’art de l’autre – les barrières de la race et de la langue sont dissoutes.
Lettre de Coomaraswamy à Mr A. F. Rhys Davids, 21 Mai 1942.
Monsieur,
A propos de l’article sur la « Réincarnation » et de l’article de fond concernant « De la renaissance » dans votre numéro du 8 janvier 1942, et avec une référence particulière à la remarque selon laquelle « En Inde c’est un point cardinal du dogme Hindou », je peux dire qu’alors il existe en Inde une doctrine de la Transmigration (au sens d’un passage d’un état en un autre), La Réincarnation (dans le sens d’un retour des individus à une incarnation sur terre) n’est pas une doctrine Hindou. La doctrine Hindou est, selon les mots de Śaṇkarācārya « qu’il n’y a pas d’autre transmigrant (saṃsarin) que le Seigneur ». Cela est l’enseignement des Upaniṣad et d’autres textes anciens, ce qui pourrait être confirmé par de nombreuses citations, et découle directement de la position de ce que nos pouvoirs ne sont « que le nom de ses actes », qui est « le seul voyant, auditeur, penseur etc… en nous », et du point de vue qui est commun à l’Hindouisme et au Bouddhisme, que c’est une grande illusion que de considérer « je suis celui qui fait ». Dans les naissances et morts successives c’est Brahma, et non pas « je » qui vient et s’en va ; « part » lorsque nous « rendons l’âme » et aussi que cet esprit « retourne a Dieu qui l’a donné ». Il s’agit également de l’enseignement du Christ, qui dit que si nous voulons le suivre nous devons haïr nos âmes, et « nul homme n’est monté au ciel si ce n’est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l’Homme, qui est le ciel ».
Le Seigneur transmigrant occupe, en effet, les corps dont le caractère est déterminé de façon simple et fatale, mais il « ne devient jamais quelqu’un », et il s’ensuit que quelqu’un qui est toujours personne peut être « unie au Seigneur » afin d’être « un seul Esprit ». Car rien de ce qui a commencé dans le temps ne peut devenir immortel ; s’il existe un moyen de s’en sortir, ce ne peut être qu’en réalisant que « je ne vis pas en tant que je, mais en Christ (ou Brahma, ou sous quelque autre nom lorsque nous parlons de Dieu) en moi ».
Avant de discuter de la « Réincarnation » nous devons être certains qu’une doctrine de la réincarnation a été maintenue par quiconque, à l’exception du Théosophiste.
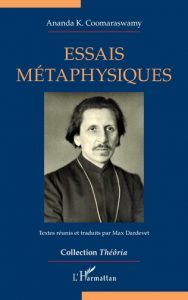

Concernant les Sphinx
Περί τάς σφίττα
τήν δἑ κόσμου ἁρμονίαυ ἡ σφίγξ…μηνύει.
(Clément d’Alexandrie)[1].
Introduction
Au cours de quelques années de travail intermittent sur l’Iconographie primitive du Sagittarius et sur Le concept d’‘‘Ether’ ’dans la cosmologie grecque et indienne, que j’espère terminer et publier, il m’a fallu étudier le Chérubin, le Gardien de l’Ancien Testament (plus particulièrement dans La Genèse, III, 24), les Sphinx qui les représentent dans l’art asiatique occidental et l’art palestinien, ainsi que le Sphinx grec. Comme cette étude est plus ou moins complète, elle peut être publiée séparément. Cependant, il faut bien comprendre que je ne discuterai pas ici de l’identité des Sphinx avec d’autres types de Gardiens du Janua Coeli. Je n’aurais rien à dire, si ce n’est par allusion, sur le Sphinx égyptien qui n’a été nommé ainsi que sur la base d’une analogie assez superficielle. Elle est d’une autre origine que celle des Sphinx de l’Asie occidentale et de la Grèce. Notre Sphinx d’origine orientale, combine le corps d’un lion (ou parfois d’un chien) avec le visage d’un homme ou d’une femme (en Grèce il s’agit toujours d’une femme)[2], des ailes et parfois les serres d’un oiseau de proie.
Les Sphinx
Les Sphinx asiatiques occidentaux sont généralement représentés dans le Wappenstil comme des paires affrontées gardant l’Arbre de Vie, de la Vérité et de la Lumière, une colonne équivalente aux volutes Ioniques. Il serait superflu d’argumenter pour dire qu’ici l’arbre et le pilier sont des symboles interchangeables d’un même référent[3]. Au-dessus de l’arbre ou pilier on voit souvent de disque ailé du Soleil. Dans les représentations sumériennes, assyriennes, phéniciennes, crétoises et chypriotes les types peuvent être masculins et barbus, ou féminins. Porter soit le κίδαπις à plumes ou un bonnet Phrygien, un filet ou des plumes en signe de royauté. Avec leurs capacités de Défenseurs ou d’assistant du troisième principe qui sépare et forme une Trinité. Les deux Sphinx peuvent être remplacés par des Griffons (avec des têtes d’aigles et des corps de lions), des serpents ailés, des hommes-scorpions ailés, ou d’autre genii. Une discussion de ces relations se rapporte à l’histoire du Sagittarius. Dans certains cas on distingue entre eux le Héros Prométhéen qui s’introduit de force, et les tient à distance à une longueur de bras[4]. Dans tous les cas leur fonction première est celle de Gardiens de la Porte du Soleil. Ce sont, en fait, ces jambages vivants et dangereux. Ils représentent tous ces contraires dont les Symplegades sont un symbole, et entre eux passe le chemin étroit qui conduit à tout ce qui demeure.
On reconnaît depuis longtemps que dans l’art Palestinien, les Chérubins de La Genèse, III, 24 sont là « afin de garder le chemin de l’Arbre de Vie », et dans Ezéchiel, XLI, 18 « un palmier entre deux Chérubins »[5], qui sont effectivement représentés par des paires de Sphinx affrontés, séparés par un arbre ou un pilier[6], et ceux de l’Exode, XXV, 18 « tu les feras aux deux extrémités du propitiatoire ». Ainsi qu’Isaïe, IV, 4 « le Seigneur des hôtes…entre des deux Chérubins » sont représentés par des Sphinx similaires qui forment les côtés des trône des monarques terrestres[7]. On peut observer que dans Le livre d’Enoch, LXXX, 4-7, les Séraphins, les Chérubins et les Ophanims (les roues) « ceux qui veillent et gardent le trône de Sa gloire ». Dans de nombreuses traditions une telle veille est une caractéristique affirmée des Gardiens de la Janua Coeli.
Mon objectif principal dans le présent article est de discuter de la signification du Sphinx dans l’art Grec. A cette fin, nous devons examiner le sens originel des archétypes et des formes qui y sont associées, dans lesquels la fonction de Gardien est prédominante. L’importance des Chérubins dans l’Ancien Testament est étudiée principalement par Philon. Ce qui peut être à la fois tiré des types Grecs et des références dans la littérature Grecque, plus particulièrement des sens dans lesquels le verbe σφίγγω, duquel dérive Σφίγξ, est employé dans la littérature d’Empédocle à Philon. Enfin les interprétations de Clément d’Alexandrie seront citées. La position de Philon peut être résumée de cette façon. Les Chérubins sont discutés à partir des paires reliées dans La Genèse, III, 24 comme les Gardiens de l’Arbre de Vie, en lien avec L’Exode, XXV, 25 comme les Gardiens du trône royal. Dans les deux cas ils sont considérés comme les représentations des pouvoirs anciens et primordiaux du Logos. Le Conducteur de l’univers, qui se tient entre eux, divise et unit à la fois. Invariablement les deux pouvoirs pris ensemble avec le Logos supérieur, médian et « troisième » est représenté par « une épée flamboyante » qui tourne dans tous les sens, alors que dans L’Exode il n’y a pas de conception visuelle. Ailleurs, le Logos est représenté par l’image vivante du Grand Prêtre et par le principe intellectuel et dirigeant qui règne en nous, l’Homme de Vérité et le Prêtre en chaque homme.
[1] Note de R. Strom. Le titre et l’introduction de cet article ne sont pas issus d’un manuscrit d’A. K. Coomaraswamy. Le texte grec peut être traduit ainsi : « …par le Sphinx on entend l’harmonie du monde ». (Clément d’Alexandrie, Stromata, V, 5, 31).
[2] ‘‘Toujours’’, c’est-à-dire lorsque nous parlons d’un Sphinx unique. Les Sphinx par paires sont parfois mâles dans le dernier art crétois, ainsi que dans le premier art corinthien. (Fig. 69 et 70 a et b).
[3] Avec le concept de pilier à la fois « remplissant une fonction structurelle » et constituant un « aspect du Dieu Soleil » (A. J. Evans, Mycenean Tree and Pillar Cult dans JHS, pp.iii, 173 (1901). Voir Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, I, 10, 9 « ils nomment le Soleil un pilier supportant le ciel », et Taittirīya Saṃhitā, IV, 2, 9, 6 « dedans est assis un aigle ». Plus généralement voir A.J.Wenslick, Tree and Bird as Cosmological Symbols in Western Asia (Amsterdam 1921). U.Homberg, Der Baum des Lebens (Helsinki 1903). Ainsi que Finno-Ugarian and Siberian Mythology, Ch III, V. Boston.
[4] Pour l’art Oriental Grec de la Crète voir Doro Levi, Early Hellenic Pottery of Crete, Pl X, 1 dans Hesperia, XIX (1945) « Une divinité ailée dominant deux Sphinx ».
[5] Les Chérubins d’Ezéchiel sont décrits comme ayant deux faces, celles d’un homme et celle d’un lion. Une conception qui est logique puisque le Sphinx combine les corps des deux. Aucun exemple Palestinien ou Grec de Sphinx à deux têtes peut être cité. Mais il existe un exemple Hittite d’environ 1000 ans av JC, en lequel un Sphinx possède deux têtes, celle d’un homme et celle d’un lion. On y remarque également une queue de serpent. (Fig 72).
[6] E.Cohn-Weiner, Die Jüdisher Kunst (1929) avec des références à notre figure 73 : Baum zwischen Cherubim…swei einander zugewandte Sphingen zu seiten eines Baumstammes saülenartiger Form…eine gute Vorstellung von phönizischen und damit auch salomonischem Stil.
[7] W.F.Albright Qui étaient les Chérubins? Biblical Archaelogist, I, 1 (1938) avec notre figure 74. Dans la mesure où la divinité peut être également représentée (Philon, Somn, I, 240-242) par un pilier, on doit noter la présence des Sphinx appariés (Cf. L’art Hittite, E.Wasmuth, Hethistisher Kunst, Pl 45, environ 800 ans av JC) formant le piédestal d’une colonne, celle-ci étant tracée à partir d’eux.
Vient de paraître un ensemble de traductions de textes de Coomaraswamy sur la sculpture bouddhiste.

Dans le numéro 23 des Cahiers de l’Unité, la première partie de la traduction du texte d’Ananda K. Coomaraswamy : Ṛgveda, 10, 90, 1, aty atiṣṭhad daśāṅgulam.