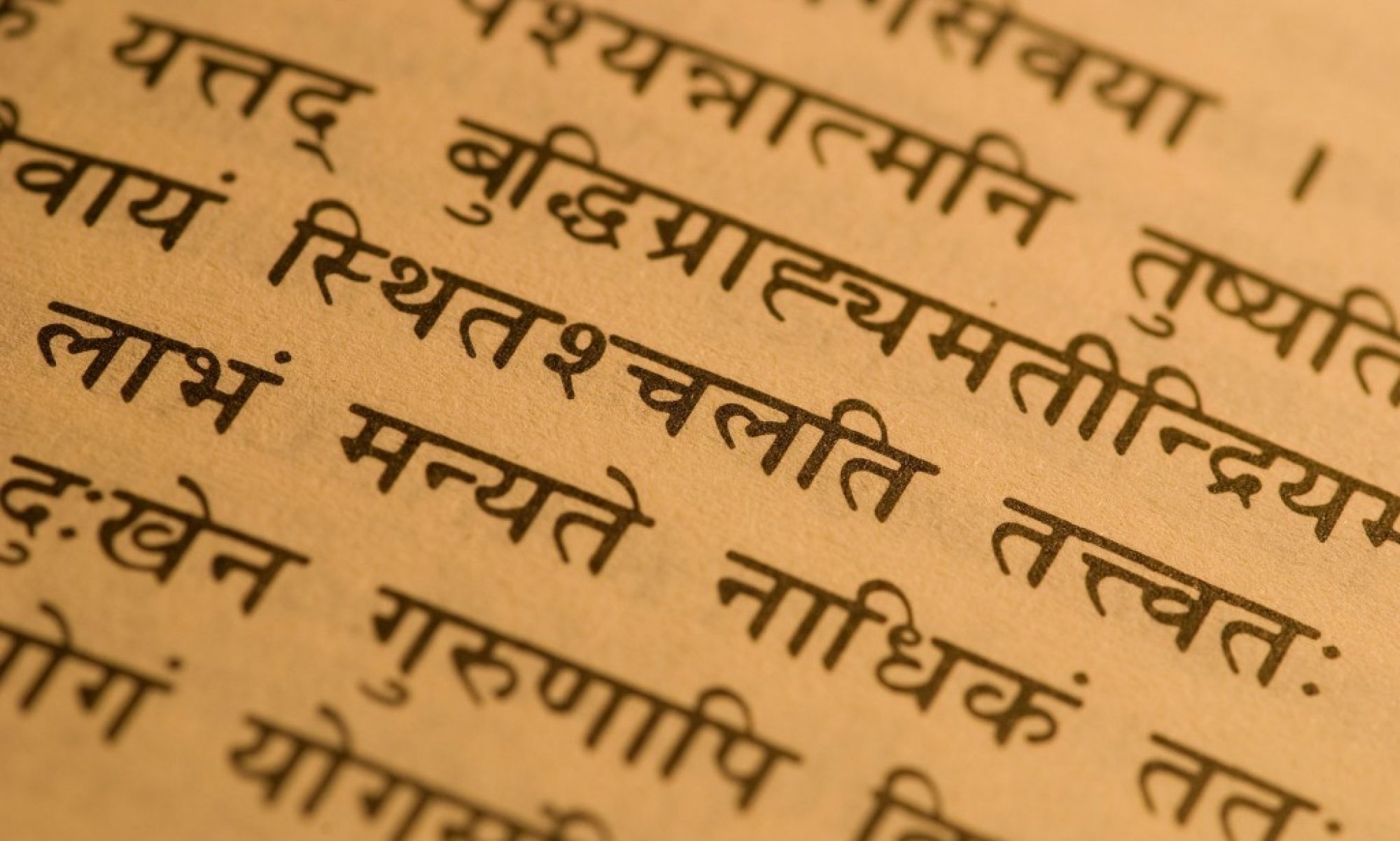Les deux bas-reliefs de Bhārhut dans la Freer Gallery of Art, Washington[1]
La Freer Gallery of Art a la chance de posséder deux grandes balustrades du thūpa de Bhārhut avec des bas-reliefs caractéristiques et très intéressants. Ces bas-reliefs sont datables de la seconde moitié du IIème siècle av. J-C. Le seul bas-relief de Bhārhut en Amérique (en dehors de ces trois, il n’y en a probablement pas d’autres en dehors de l’Inde, où presque tout ce qui reste est rassemblé au Musée de Calcutta) où se trouve la tête et le buste d’une Yakṣī ou Devatā au Museum of Fine Arts de Boston.

Le premier bas-relief de la Freer Gallery of Art (Pl. XXXIV) est une représentation typique d’un thūpa, avec des adorateurs divins et humains. Celui-ci ayant un Deva volant à gauche qui jette une pluie de fleurs, depuis un panier porté dans la main droite ; et la Supaṇṇa à droite apporte l’offrande d’une guirlande florale. Des adorateurs humains en dessous, un homme et une femme sont debout les mains jointes (en position de katañjali, telle qu’elle est définie en Vv, A, 7), tandis qu’un autre homme et une femme sont à genoux. Deux autres personnes, ou plus probablement une seule en deux positions successives, font une circumambulation du thūpa. Le thūpa est situé dans un bosquet d’arbres sāl.
Considéré aussi simplement le thūpa bouddhiste est un monument funéraire du Parinibbāna Buddha, ou ‘‘Extinction complète’’, c’est-à-dire la mort ou comme le mot (qui fait référence à l’extinction complète de la flamme de la vie dans le Grand Éveil) est souvent rendu par la ‘‘Grande Mort’’[2]. La pleine signification du thūpa est plus complexe[3]. C’est essentiellement une structure en forme de dôme renfermant un espace rempli, et dépendant d’un axe central dont seule cette partie est représentée et visible, s’élève au-dessus du thūpa en tant que ‘‘mât’’ (yaṭṭhi) ou ‘‘poteau sacrificiel’’ (yūpa) et peut être la ‘‘poignée’’ d’un seul parasol (chattra) ou d’une série de parasols superposés (chattravalli). L’ensemble de la construction comporte donc deux parties, l’une s’étendant du sol au sommet du dôme ; et l’autre une superstructure constituée du ‘‘petit palais’’ (hammikā), une structure carrée qui correspond à la fois morphologiquement et dans son importance essentielle, à la ‘‘lanterne’’ d’un dôme construit[4], et au ‘‘mât’’ susmentionné. Tout ce qui est commun à ces deux parties, ce qui passe d’une partie à l’autre, c’est l’axe vertical précité. La première partie, dont le sol est la terre et le dôme le ciel, est le monde, l’univers c’est-à-dire à sa ressemblance ; la seconde partie un empyrée extra-cosmique dont le niveau céleste le plus bas est représenté par le ‘‘petit palais’’ (des Devas) est une série indéfiniment étendue de niveaux supérieurs de références par une série de parasols qui sont en même temps les ‘‘cieux’’ et autant de ‘‘mondes’’, la couronne de la tête de l’Homme Universelle dans quelque sphère que ce soit qu’il soit considéré comme ‘‘comblant’’. L’axe vertical est l’Axis Mundi ; un thūpa est érigé ‘‘aux quatre quartiers’’, c’est-à-dire là où les quatre directions se rencontrent (les portes du thūpa, en fait, font face aux quatre quartiers) et de façon analogue au ‘‘nombril de la terre’’, représenté par le lotus ou la roue qui est tracée en tant que plan sur le sol et à travers lequel le centre de l’axe vertical passe vers le bas, passant par le sommet du dôme au-dessus ; la cavité d’où elle émerge correspondant à l’‘‘œil’’ solaire ou à la sablière de comble de la construction d’un dôme, dont l’‘‘œil’’ est la ‘‘Porte du Soleil’’ à travers laquelle on est totalement libéré des conditions spatiales et temporelles. Cet axe incarne le principe de toute l’expansion spatiale du bâtiment, et comme le skambha (stauros) qui relie et sépare à la fois le ciel et la terre, il coïncide avec la foudre adamantine (vajra) ou le bâton (de lumière) avec lequel le héros solaire a frappé le serpent chtonien au commencement. De nos jours, en effet, le gnomon du constructeur à partir duquel les mesures sont effectuées, étant enfoncé dans le sol au centre du bâtiment prévu, transpercerait la tête du serpent chtonien, et c’est ainsi que le site est rituellement ‘‘stabilisé’’. Alors la pleine signification de l’axe vertical dans la théorie architecturale indienne, ne pouvait pas être mieux exprimée que dans les termes d’Héraclite, « La foudre gouverne toutes choses ».
Le corps du thūpa consacre (dhātu, ‘‘dépôt’’ ou ‘‘élément’’, d’où dhātu-gabbha = dāgaba, et par corruption ‘‘pagode’’) la ‘‘vie’’ (jīvita) du bâtiment et la ‘‘trace’’ physique au moyen de laquelle une connexion peut être maintenue entre les vivants et les morts[5]. Cela peut nous permettre de mieux comprendre le principe important selon lequel le thūpa n’est pas simplement une tombe ou un rappel du Deus absconditus mais est aussi à sa ressemblance, tout comme le tumulus funéraire védique avait été « à la fois maison[6] et représentation » (gṛhaṃvā prajñānaṃ vā, Śatapatha Brāhmaṇa, XIII, 8, 1, 1) ; en d’autres termes, le thūpa est une image du Buddha exactement dans le même sens qu’à ce moment là, le trône est le parasol, ou l’arbre, sont les représentants du Buddha, auxquels l’honneur peut être rendu comme pour lui-même en personne[7], et dans le sens où un ou deux siècles plus tard l’icône anthropomorphique devient le support de la contemplation ; euphémisme des textes Pāli, qui traitent l’avènement du Buddha comme un événement historique, anticipant et, pour ainsi dire, nécessitant le développement iconographique ultérieur.
Dans son aspect anthropomorphe, le corps du thūpa se compose de trois parties, le dôme, le tambour et la base correspondant au crâne, au torse et aux pieds, « La forme la plus grossière de Prajāpati, cette forme cosmique. Sa tête est le ciel (svar), l’espace (bhuvas)[8] le nombril, les pieds de la terre (bhūr) ; l’œil est le soleil […] l’esprit essentiel de tous, l’œil de tous[9] […] Ceci est la forme qui soutient tout à partir de Prajāpati ; tout ce monde est caché en lui, et il est dans ce monde entier » (Maitri Upaniṣad, VI, 7, cf. Atharva Veda, X, 7, 32), où nous n’avons qu’à substituer la ‘‘Suprême Identité’’ (mahāpurisa) des textes bouddhistes au Prajāpati ou Puruṣa des Upaniṣad. Nous avons déjà fait référence à l’‘‘œil du dôme’’ à travers lequel la lumière du ciel pénètre l’espace fini enfermé (quelle que soit sa solidité, ce qui correspond au fait qu’il n’y a pas de vacuité dans l’espace, et répète la représentation de l’espace du monde par la construction solide de l’’autel du Feu Védique, qui est également le corps cosmique de ‘‘Agni-Prajāpati’’) ; nous reconnaissons maintenant que dans l’analyse anthropomorphique cet ‘‘œil du dôme’’ (architecturalement la cavité du ‘‘mât’’) correspond au foramen du crâne où émerge un puits de lumière inversement vers le haut, conformément au Lalita Vistara (Lefmann, p.3), décrivant le « rayon nommé ‘‘Ornement de Lumière de la gnose discrète, le rappel des anciens Buddhas’’[10] qui dans une synthèse appelée la ‘‘disposition des ornements[11] des Buddha, surgit au-dessus de la tête depuis l’ouverture du turban (uṣṇīṣa -vivantarāt)[12]. » Le thūpa avec un mât est donc l’équivalent formel de cette dernière image anthropomorphique du Buddha dans alaṃkāra-vyūha samādhi, particulièrement familière dans l’art du Siam, dans laquelle āloka-alaṃkāra raṣmi s’élève sous la forme d’une flamme à partir d’uṣṇīṣa (désormais interprétée comme une protubérance crânienne)[13].
La notion précédente d’uṣṇīṣa, ‘‘turban’’ (le mot à l’origine n’avait jamais un autre sens) nous conduit à mentionner ici l’un des détails les plus marquants de la terminologie architecturale, la désignation à savoir, de l’adaptation de la balustrade par laquelle le thūpa est clos, orné et gardé ; car alors par ailleurs le ‘‘haut’’ de n’importe quel mur est toujours siṣa ou matthaka, ici parce que le thūpa lui-même, qua ‘‘dôme’’, est la tête véritable de l’Homme Universel, la margelle de la balustrade, qui encercle la ‘‘tête’’ comme un ruban, s’appelle précisément uṇhīso, ‘‘turban’’. La Personne, en d’autres termes, que le thūpa représente est architecturalement uṇhīso-sīso, conformément à Dīgha-Nikāya, II, 19 et III, 145.
Revenons maintenant à ce qui est architecturalement un dôme, d’un point de vue anthropomorphique la couronne de l’Homme Universel, et d’un point de vue cosmique le toit du ciel du monde ; observons premièrement que dans le dôme contemporain en bois, la construction des chevrons convergent et s’appuie sur la sablière de comble circulaire (kaṇṇikā) représentant le soleil « l’unique lotus du ciel » (Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, VI, 3, 6), celui d’un parasol dont les baleines[14] s’unissent à leur point de contact avec la poignée ; et qui fonctionnellement a aussi la qualité de donner de l’ombre ou un abri (chāyā), ce qui est commun aux chadana, ‘‘toit’’ et chattra ‘‘parasol’’. Tout cela est en accord avec le fait que la tête de l’Homme Universel a la forme d’un parasol (chattrākāra-śīrṣaḥ ou śiraḥ, Divyāvadāna, passim) aussi bien comme couronnée ou enturbannée (uṇhīso-sīso).
Le mot thūpa (sanskrit, stūpa) étant principalement la tête ou le sommet de quoi que ce soit (et peut-être même aussi étymologiquement, ‘‘faîte’’, ‘‘touffe’’, ‘‘toupet’’ etc. Cf. ‘‘couvre-tête’’, ‘‘chapeau’’ et ‘‘crête’’ = thūpa ou tout monticule), par exemple, le sommet d’un arbre dans Ṛgveda, I, 24, 7, tête ou pointe de flamme en III, 29, 3 et VII, 2, 1, tête dorée d’un Āṅgiras dans X, 149, 5, le sommet ou le nœud du sommet de la tête de Viṣṇu dans Vājasaneyi Saṃhitā, II, 2, expliqué dans Śatapatha Brāhmaṇa, I, 3, 3, 7, par sikhā, ‘‘sommet’’, ‘‘flamme’’, etc. Cf. sikhara comme ‘‘flèche’’[15] ; et architecturalement ‘‘dôme’’, par exemple, Śānkh. Gr, S, III, 3, 7, Jātaka, VI, 117, Mahāvana, XXXI, 13 ; où nous avons un parallèle verbal à l’équivalent morphologique du thūpa comme ‘‘dôme’’ avec la tête de l’Homme Cosmique qu’il représente. Le thūpa est donc, comme Barua l’a souligné par ailleurs (Bhārhut, III, p.11) synonyme à ce qu’il correspond, il peut contenir une relique, à laquelle il ressemble en fait. En ce qui concerne cette ressemblance, on peut remarquer que les thūpa indiens les plus anciens, par exemple celui de Piprāhvā, où le diamètre est de 34m80 et la hauteur de 6m60, est plus proche de la forme crânienne que ne le sont les types plus développés des périodes ultérieures ; et l’universalité de ce principe est illustrée par le fait que « les tumuli de Grande-Bretagne varient selon les types de têtes qu’ils contiennent. Les tumuli, allongés, du néolithique contiennent des morts à crânes longs. En revanche, les tumuli ronds de l’âge du bronze comportent des crânes ronds ou brachycéphales. » (McCudy, Human Origins, II, 1924, p.296).
Le premier Mahākapi Jātaka (N°. 407, Jātaka, III, 370sq) contient un matériau analogue de la plus grande importance pour la compréhension de la forme d’un thūpa. Ici, le Bodhisattva (le ‘‘Grand Singe’’) meurt et son corps reçoit des obsèques royales. Après la crémation, le crâne (sīsa-kapāla) est incrusté ou lié avec de l’or (Cf. hiraṇya-stūpa dans Ṛgveda, X, 149, 4) et placé sur une pointe de lance à la porte du roi et honoré (pūjaṃ karesi) avec une lampe, des parfums, des guirlandes etc. Puis, en le considérant comme une relique (dhātu) le roi en fait un sanctuaire (cetiya) et l’honore toute sa vie de la même manière. Il est suffisamment clair que le cetiya ici devait être en fait un dhātu–gabbha ou semblable à un thūpa du Tathāgata ; mais ce qui est d’un intérêt particulier, c’est le fait que le crâne posé sur une lance est déjà un parasol en effet, et comme le dôme du thūpa par rapport à son axe vertical.
L’équivalence du dôme avec le parasol et de ceux-ci au crâne s’étant développée (l’importance du parasol dans l’histoire de l’architecture indienne a depuis longtemps été soulignée par d’autres, notamment par Simpson et Longhurst), il ne reste plus qu’à redire que l’élévation d’un ou deux parasols au-dessus du dôme d’un thūpa fait référence à l’élévation de la couronne de l’Homme Universel dans quelque sphère que ce soit, il est considéré comme omniprésent ; pour lequel une autorité spécifique d’élévation peut être citée dans le Lalita Vistara (Lefmann, p.424), « Il est nommé ‘‘Celui dont la tête est hors de vue’’ car il s’élève au-dessus de tous les mondes » (anavalokita-mūrdhna ity ucyate sarvalokādabhyudgatatvāt).
De tout ce qui a été dit plus haut, il s’ensuit que le thūpa, en représentant ‘‘l’extinction complète’’ (parinibbāna, un mot qui signifie aussi perfectionnement et peut être aussi utilisé dans ce sens par rapport à l’achèvement des étapes successives et à la formation d’un cheval noble, Majjhima-Nikāya, I, 446)[16] de la Voie, est une représentation du ‘‘tout’’, le Buddha cosmique et supra-cosmique, immanent et transcendant, tout comme l’autel du Feu védique avait été une représentation et une construction du ‘‘tout’’ (kṛtsna) Agni- Prajāpati ‘‘limité et illimité’’ (parimitāparimita)[17] ‘‘exprimé et inexprimé’’ (niruktānirukta) avec tous les autres contraires (non pas ‘‘opposés’’, car il n’y a pas ‘‘d’oppositions’’ du fini et de l’infini, dont le premier est inclus et ne limite pas ce dernier, comme cela apparaît à propos de l’axe de l’ensemble de la structure dont l’axe de longueur indéterminée et non mesurable n’est en rien affecté par la délimitation d’une ‘‘partie’’ de cette longueur par le sol et le toit du thūpa lui-même, qui représente l’univers, le royaume de la dimension et du nombre, – māna, saṅkha). Et tout comme dans la construction de l’autel du Feu, c’est bien lui-même que le sacrifiant construit avec lui (un aspect du travail sur lequel Mr. Mus a si justement insisté), c’est lui-même qu’il fait en même temps et encore une fois (l’immanence de la divinité ayant impliqué une descente de l’unité à la multiplicité, descente qui est littéralement une ‘‘perte’’ (visraṅsana), un dénouement des liens, parvāni, et donc de la mort), donc l’adorateur qui vérifie ou réalise réellement (sacchikaroti) en personne la signification du thūpa et s’identifie au Buddha ‘‘fini’’ qu’il représente, revient avec lui de la multiplicité à l’unité ; « et ayant été multiple, ne font plus qu’un » (Saṃyutta–Nikāya, II, 212 etc.), ce qui revient à ‘‘mourir’’.
Le thūpa, comme d’autres œuvres d’art bouddhistes (trop longtemps négligé par l’étudiant du ‘‘bouddhisme’’ en tant que tel) est donc autant une exposition de la doctrine bouddhiste que les Piṭakas eux-mêmes. Dans notre exposition, nous avons considéré le thūpa comme un monument éloquent et nous avons gardé à l’esprit que le but de l’oratoire bouddhiste avait toujours été, non pas d’évoquer un frisson esthétique, mais de communiquer une vérité, et donc comme le dit Dante de sa Divine comédie, « afin de conduire les hommes de l’état de misère à l’état de bénédiction ». Une exégèse est au moins aussi nécessaire pour les œuvres plastiques traditionnelles que pour les œuvres d’art littéraires traditionnelles, dont la beauté n’est pas une fin en soi mais l’aspect attrayant de leur contenu. Une exégèse est nécessaire (et encore plus maintenant qu’alors), dans la mesure où les hommes ne sont pas souvent « conscients du récit (ākhyāna) en tant que tel, et vivent ainsi sous le joug de la mort », et être ‘‘littéraliste’’ (padaparama) c’est être ‘‘conduit’’ (neyya, Aṇguttara-Nikāya, II, 135) ; « l’image n’est pas dans les surfaces esthétiques » (Lankāvatāra Sūtra, II, 117) ; et ainsi pour les bas-reliefs comme pour les textes, « Lorsque l’analyse des significations dans leur sens littéral et dans leur sens symbolique a été vérifiée » (attha-paṭisambhidhā sacchikatā odhiso vayñjanaso) on doit « les expliquer par de nombreuses paraphrases, les enseigner et les clarifier, les rendre intelligibles, les établir, les ouvrir, les disséquer et les étaler. » (Aṇguttara-Nikāya, II, 160)[18].
Dans notre bas-relief, il y a des adorateurs divins et humains, et certains d’entre eux montrent l’aspect d’un Buddha ‘‘fini’’ (certainement pas dans le monument en tant que tel, pas plus que dans le cas du culte des images anthropomorphes, où ce n’est pas l’argile en tant que telle, mais les Immortels représentés par elle à qui l’honneur est rendu, comme on le tient pour acquis dans le Divyāvadāna, Ch. XXVI) en faisant le geste oriental des mains jointes (añjali), comme l’attitude européenne de prière, tandis que deux autres, ou plus probablement le même vu deux fois, font le tour du thūpa, en tournant à droite ou en direction du soleil. Tout cela répond à ce que l’on peut citer à partir des textes : « Le corps d’un Tathāgata devra être traité comme on traite le corps d’un roi Cakravartin » – c’est-à-dire dûment enveloppé et brûlé sur un bûcher funéraire (citaka), cf. aussi le Mahākapi Jātaka tel que cité ci-dessus – après quoi « un thūpa devrait être élevé pour le Tathāgata aux quatre croisements[19]. Et quiconque y placera des guirlandes, ou du parfum, ou de la couleur[20], ou y fera des salutations[21], ou là-bas clarifiera sa disposition[22], ce sera pour leur bien et leur bonheur durables […] Là, où la communauté ayant la foi peut dire ‘‘Ici le Tathāgata a été totalement éteint (parinibbuto) avec cette réalisation du ‘‘nibbāna’’ qui est sans residuum (reste) d’hypothèse, c’est pour lui un endroit magnifique et profondément émouvant (dassanīyaṃ saṃvejanīyaṃ ṭhānam) […] Et là viendront en de tels endroits[23] des frères et sœurs, et des disciples laïcs ayant la foi qui diront ‘‘Ici le Tathāgata […]’’ ; si l’un de ceux qui sont en pèlerinage vers un tel sanctuaire (cetiya) devait mourir avec une disposition clarifiée, quand il est séparé du corps, après la mort il va s’élever dans le monde céleste disparu[24] » (Digha-Nikāya, II, 161 et 140-141). Dans le texte qui précède dassanīyam, littéralement ‘‘légèrement’’ ou ‘‘digne de vue’’ est l’un des mots habituels pour ‘‘beau’’, et il ne fait aucun doute qu’une expérience esthétique s’y réfère, sans aucun doute qu’id quod visum placet est pour ceux qui sont ainsi satisfaits, une chose de beauté[25] : saṃvejanīyam, littéralement ‘‘remuer’’ ou ‘‘exciter’’ n’est pas le ‘‘frisson’’ de cette sensation, mais un être ‘‘ému’’ dans le sens où c’est le but de l’œuvre d’art, non pas seulement delectare, mais beaucoup plus probare, movere (ou docere, flectere). Ici, où que ce soit, « L’art a à voir avec la cognition » ; le ‘‘frisson’’ est celui de la compréhension. L’Aṇguttara-Nikāya, I, 36 souligne qu’ils sont plutôt rares ceux qui sont ainsi ‘‘ravis’’ (appakā te sattā ye saṃvejanīyesu ṭhanesu saṃvijjanti), ou être ravis c’est faire un effort radical (yoniso padahanti, mieux peut-être « sont renvoyés intérieurement. ») ou de saisir la saveur[26] du sens (attha-rasasa […] lābhino). Nous avons beaucoup d’autres contextes dans lesquels il est enjoint aux moines et aux nonnes de ne pas regarder les œuvres d’art (vraisemblablement laïques) « pour le plaisir » ; dans ceux cités ci-dessus, nous avons, d’autre part, une indication explicite de l’esthétique et de l’expérience intellectuelle que le bouddhiste croyant peut tirer d’œuvres d’art spécialement bouddhistes (telles que celles que nous envisageons), et du fait que ces œuvres d’art avaient pour raison d’être [En français dans le texte. NdT.] non seulement de plaire ou de ‘‘décorer’’ mais de démontrer une image qui est plutôt évoquée que donnée par les surfaces esthétiques elles-mêmes et induire chez le spectateur une activité et une disposition intérieure correspondante. En l’espèce, la nature de cette disposition ne fait aucun doute ; car, bien que l’on ne puisse pas donner d’autres raisons qu’un śānti-rasa avait encore été reconnu par les rhétoriciens systématiques, il est vrai que la ‘‘saveur’’ (rasa) à saisir ici était précisément celle de la ‘‘paix’’ (śānti), la disposition de celui qui « est en paix, se réjouit de l’état de paix et porte son corps ultime » (Aṇguttara-Nikāya, II, 18), « la paix parfaite, nibbāna, état d’‘‘où il n’y a plus de peur’’ (Aṇguttara-Nikāya, II, 24). En dernière analyse, l’œuvre d’art est une exposition qui suppose d’une part un exposant qualifié à la fois sur la lettre et le principe (attha, dhamma, II, 7 et Aṇguttara-Nikāya, II, 151 ; attha, vyañjana, Atharva Veda, 23), et d’autre part un auditeur de même qualification ; dans le cas particulier de notre bas-relief nous avons essayé de jouer le rôle du premier, et nous pouvons espérer que le lecteur jouera le rôle du second.

Le second bas-relief de la Freer Gallery peut être décrit plus brièvement. Ce que nous y voyons est un bâtiment à deux étages dans lequel le Buddha, représenté par un autel, une roue et un parasol, est en résidence, à côté de lui se trouvent quatre fidèles ; deux hommes debout et deux femmes agenouillées. A droite et s’approchant du spectateur, un roi et son conducteur de char, dans un char à deux chevaux. L’avant de cette même procession, qui fait apparemment la circumambulation du bâtiment, se compose d’un cavalier et d’un cornac sur un éléphant, tous deux vus de derrière ; le cavalier vient de passer la porte de l’ārāma dans laquelle se trouve le bâtiment, ce dernier a des difficultés avec sa monture qui s’est arrêtée et dressée pour abattre la branche d’un arbre. Ce qui reste de l’inscription se lit : atanā maraṃtā, « bien qu’ils meurent eux-mêmes », mots qui en eux-mêmes sont loin d’expliquer le sujet du bas-relief.
Une scène très similaire, dont le bas-relief de la Freer Gallery a été considéré comme un doublet, est à Bhārhut sur le Pasenajit Pillar (Cunningham, Stūpa of Bhārhut, Pl.XIII, à droite). Nous avons ici la circumambulation d’une cavalcade royale entourant ce qui est apparemment (et sans doute en fait) le même bâtiment ; un roi, désigné par le parasol royal, conduit un char à quatre chevaux, accompagné d’un porteur de cāmara et de deux autres préposés. Il est précédé de deux hommes à pied et d’un cavalier, suivi de deux cornacs à dos d’éléphant. Dans le bâtiment, deux personnes (qui sont probablement le roi susmentionné, qui serait entré ‘‘seul’’ dans la résidence du Buddha) se tiennent les mains jointes à côté du Buddha, qui est représenté par un autel, une roue et un parasol. Les inscriptions se lisent bhagavato dhammacakka, « La Roue de la Loi, ou la Roue de la Parole, du Bienheureux », et rājā pasenaji kosalo : Rājā Pasenajit de Kosala. Il ne fait aucun doute que la scène représente la visite de Pasenajit au Buddha qui était en résidence à Meḍalumpa près de Nagaraka, comme cela est indiqué dans Atharva Veda, 65-69 et Majjhima-Nikāya, II, 118f. Le Dhammacetiya Sutta (Majjhima-Nikāya, II, 118f) est appelé ainsi parce que Pasenajit aurait prononcé des ‘‘paroles contemplatives’’ (dhamma-cetiyāni) à la louange du Buddha, et non parce que le Buddha avait été pensé comme représenté dans le bâtiment lui-même par un dhamma-cakka. Le bâtiment n’est pas, du point de vue du récit (ākhyāna), un cetiya, mais une résidence, vihāra, ou, comme le désigne le Dhammapada Atthakathā, ‘‘une cellule parfumée’’, gandhakuṭi[27]. En même temps, il ne faut pas oublier que le bâtiment avec son occupant vivant tel que représenté dans les deux bas-reliefs, s’il est considéré en dehors du récit (ākhyāna) qu’il illustre, est l’image d’un véritable temple bouddhiste (vihāra, gandhakuṭi) dans lequel le Buddha disparu est correctement représenté par le dhamma-cakka, conformément au logos (Verbe), « Celui qui voit le Dhamma, me voit » (Saṃyutta-Nikāya, III, 120)[28]. En même temps, le temple avec son icône représentant le Deus absconditus correspond exactement au thūpa avec sa relique, l’espace intérieur étant le gabbha ou matrice dans les deux cas. Les étages inférieurs dans les deux cas sont le monde à l’image, dans lequel le Buddha immanent est à la fois enterré et vivant, tandis que l’étage supérieur correspond à la superstructure du thūpa, tout comme la multiplication des étages supérieurs dans la dernière architecture du temple à la multiplication des parasols au-dessus d’un thūpa.
Pour revenir maintenant au bas-relief de la Freer Gallery, nous devons remercier MM. Barua et Sinha (Bhārhut Inscriptions, p.65) d’avoir reconnu que le texte fondamental attanā maraṃtā appartient au Dhammapada Atthakathā, I, 358 « Maintenant, les parents du Pleinement Éveillé ne prennent pas la vie des autres, bien qu’ils meurent eux-mêmes » (attanā maraṃtā’pi). Il s’ensuit que le bas-relief de la Freer Gallery n’est pas un doublet de celui du pilier de Pasenajit, mais concerne les événements postérieurs à la ‘‘visite de Pasenajit’’ à laquelle le Dhammapada Atthakathā a fait référence (I, 356) comme ayant eu lieu à Uḷumpa, manifestement à identifier à Meḍalumpa du Dhammacetiya Sutta. Le contexte des mots de l’inscription montre, en fait, que les personnages du char doivent être ceux du roi Viḍūḍabha et de son général Dīghakārayaṇa, ceci en accord avec le texte (I, 357) «Viḍūḍabha partit donc avec une grande armée, disant ‘‘Je tuerai les Śākyas’’,» ces mots précédant immédiatement la phrase citée ci-dessus et dont les mots de l’inscription forment la conclusion. Les personnages dans le gandhakuṭi sont peut-être ceux de Viḍūḍabha et de ses disciples, mais rien dans l’histoire ne suggère qu’une visite a été rendue au Buddha à l’intérieur des portes en cette occasion ; une rencontre de Viḍūḍabha avec le Buddha a déjà eu lieu à l’extérieur. Nous considérons que ceux qui se trouvent dans le sanctuaire sont des visiteurs non identifiés.
[1] [Article d’Ananda K. Coomaraswamy paru dans Journal of the Indian Society of Oriental Art, pp.149-162, Juin-Décembre, 1938. NdT]
[2] Le Parinibbāna est en fait la ‘‘troisième mort’’ du Buddha, la première étant la ‘‘descente’’ (avakramaṇa, avataraṇa) lorsqu’il est conçu et le Nibbāna du Grand Éveil sa seconde mort. Cf. Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, III, 9 et Aitareya Āraṇyaka, II, 5.
[3] L’analyse la plus complète et la meilleure est celle de Paul Mus, dans son traité monumental Bārābuḍur, Les origines du Stūpa et la transmigration, BEFEO, 1932-1935. Ce livre n’est pas seulement une discussion sur Bārābuḍur, mais une analyse pénétrante de la motivation et du développement de l’architecture indienne en général.
[4] Et par le nom symbolique du texte de Taittirīya Saṃhitā, III, 3, 5, 5, « Le ciel est la ‘‘lumière’’ du cosmos ». On peut ajouter que toutes les correspondances supposées ci-dessus sont plus amplement discutées dans mon Symbolisme du Dôme, Uṣṇīṣa et chatra : turban et parasol, Svayamātṛṇṇā : Janua Coeli, La Porte du Ciel, 2008 et L’Arbre Inversé, 1984.
[5] La fonction propre des reliques comme support de la contemplation est accomplie lorsqu’on dit, comme dans le Mahāvaṃsa, XVII, 43, 52 et XXXI, 98, 108, assumer la forme du Buddha et accomplir ses miracles. Le culte des reliques, comme beaucoup d’autres choses d’origine paléolithique et de répartition mondiale, n’est que ‘‘superstition’’ au sens propre de ce mot, celui de quelque chose qui est ‘‘dépassé’’ depuis longtemps et n’est plus compris.
[6] Quand à la ‘‘maison’’ on peut observer que le thūpa, ou tout autre tumulus funéraire primitif, est essentiellement un ‘‘dôme’’, non seulement d’apparence formelle, mais en même temps dans le sens où le latin domus, le sanskrit dama, c’est la ‘‘maison’’. Dans le cas présent, le défunt est le daṃpati, ‘‘le maître de maison’’, qui comme tombe ressemble à toutes les autres maisons, imitant la maison de l’univers. La maison archétypale, la cabane ou la tente peuvent être considérés comme ayant été essentiellement une construction en forme de ‘‘dôme’’ ; et cela, du moins en ce qui concerne l’Inde (mais c’est aussi, cf. l’‘‘Igloo’’ des Esquimaux et de très nombreuses autres constructions ‘‘primitives’’ plus ou moins de type ‘‘ruche’’) cela peut-être la réponse à la question posée par Strzygowski, « D’où vient l’idée de construire une coupole avec des chevrons ? »
[7] Kālingabodhi Jātaka, Jātaka, IV, 229 ; l’arbre de la Bodhi est planté aux portes du jardin de Jetavana, il est à la fois sa ‘‘protection’’ (saraṇa) et un ‘‘lieu où une cérémonie peut être effectuée’’ (pūjanīyaṭṭhānā) pour le Tathāgata en son absence temporaire ; « Ce sera ma résidence dûment désignée » (nibaddhavāsa viya). Ainsi, l’Arbre représente le Buddha lorsqu’il n’est pas en résidence dans le Gandhakuṭi. Par contre, un ‘‘sanctuaire de reliques corporelles » (sarīraka cetiya) est impraticable tant qu’un Buddha n’est pas encore complètement éteint (parinibbuto-kāle) : mais il est sous-entendu que lorsque cet événement a eu lieu, le Buddha peut aussi bien être représenté par un sanctuaire ou des reliques corporelles, c’est-à-dire un thūpa, comme par l’Arbre.
[8] Bhuvas, est le nominatif pluriel de bhū comme lieu du devenir, lieu de la naissance. Un lieu d’origine en ce sens cf. Ṛgveda, X, 72, 4, bhuvas āśas ajāyata, « d’‘‘être’’ les quartiers ont été apportés ». Bhū est donc le centre, le ‘‘nombril’’ et la source à partir de laquelle l’aire de tout locus (loka, monde) est en extension, et bhuvas au pluriel toute la série de ces centres qui collectivement forment l’Axis Mundi s’étendant de la terre au ciel, et cette série entière de niveaux correspondants, et donc l’atmosphère, antarikṣa. C’est sans doute parce que le tambour du thūpa (comme le corps d’un autel) correspond au corps (comme distinct de la tête et des pieds) de la Personne Cosmique, et en même temps à l’atmosphère (comme distinct du ciel et de la terre) du cosmos lui-même, que les guirlandes florales dont le tambour du thūpa et les côtés de l’autel sont décorés à Bhārhut sont portés par des oiseaux ; comme dans notre bas-relief. On peut également remarquer que lorsque le tambour du thūpa est également décoré avec des dalles appliquées de pierres sculptées, celles-ci sont appelées un ‘‘manteau’’ ou un ‘‘vêtement’’ (kañcukā), étant en fait un ‘‘vêtement’’ qui recouvre le ‘‘corps’’ de la Personne cosmique.
[9] « Pour l’Homme Universel, le monde dimensionné dépend de l’œil, dans la mesure où c’est l’œil qui range les choses dimensionnées. Vraiment, l’œil est la vérité ; car stationnée dans l’œil, la Personne se déplace parmi tous es objets » (ibid). L’identification du Soleil avec l’‘‘Œil’’ tout au long de la tradition védique et dans la désignation fréquente du Buddha comme « l’œil dans le monde » (cakkhuṃ loke), par exemple, Dīgha–Nikāya, II, 158 « Trop tôt l’œil du monde est entré » (dans le sens où le soleil est censé ‘‘se coucher’’, ou en sanskrit ‘‘rentré à la maison’’, une expression qui est aussi utilisée pour l’Arhat.
[10] pūrva-buddha-anupasmṛty-asaṅga-ājñāna-loka-alaṃkāra nāma raśmi
[11] Buddha-alaṃkāra-vyūha nāma samādhi
[12] C’est encore en vertu d’une gnose (jñāna) qu’il est dit dans le Saddharma-Puṇḍarīka, d’un certain Bodhisattva que « le turban sur sa tête brille » (mūrdhny-uṣṇīṣo vibhāti). Nos traductions supposent que dans ces passages uṣṇīṣa n’a pas encore acquis son sens ultérieur de ‘‘protubérance crânienne’’, et que vivara se réfère à l’ouverture dans le turban, dont les plis ne recouvrent jamais réellement le haut de la tête. D’autre part, il est fort possible que uṣṇīṣa dans ces contextes signifie ‘‘protubérance crânienne’’ auquel cas vivara sera le ‘‘foramen’’ (brahmarandhra, sīma, vidṛti) ; et cela est d’autant plus probable qu’en Pāli vivara est souvent une ‘‘sortie’’ dans le sens de ‘‘sortie’’ du monde, une sortie que le Buddha a trouvé et avec laquelle est liée son épithète de vivaṭa-cchada, le ‘‘sans toit’’ en se référant non seulement à son abandon de la vie familiale et à ‘‘n’avoir pas où poser la tête’’, mais encore plus à sa ‘‘sortie du cosmos’’, et de même de nombreux Arhats sont dits ‘‘percer le toit’’ de toute maison d’où ils partent, et comme le Buddha lui-même exulte d’avoir brisé le toit de la maison de la vie (Jātakam, I, 76). Le Buddha, en d’autres termes, est hypèthre, comme l’arbre de la Bodhi par lequel il peut être représenté dans les sanctuaires (cetiya) qui sont certainement vivaṭa-cchada.
Quel que soit la signification que nous donnons à uṣṇīṣa dans un contexte (uṇhīsa est toujours le ‘‘turban’’ dans Jātakam, V, 129 uṇhīsam sīse paṭimuncitvā, cf. Ṛgveda, X, 27, 13 śīrṣṇā śiraḥ prati dadhau varūtham). Le Dr Kramrisch a tout à fait raison de comparer le crâne avec le thūpa « dans la forme et la signification » et de voir dans l’élévation de la protubérance crânienne une représentation des « possibilités les plus élevées d’être », quel que soit le ‘‘monde’’ que nous envisageons, « le ciel est sa tête » (Atharva Veda, X, 7, 32).
[13] Cf. Bhagavad Gītā, XIV, 11, « Quand la lumière gnostique surgit (prakāṣa upajāyate, jñānaṃ yada) des portes du corps, alors on peut savoir que l’homme est adulte ». C’est en effet précisément en tant que personne adulte que le Buddha manifeste cette lumière ; c’est dans la ‘‘synthèse’’ (samādhi) précisément, que la pleine stature d’un homme est atteinte, alors seulement il est vraiment bhavitatā, mahattā.
[14] sākkā, Sutta Nipāta, 688 ; la désignation des baleines comme ‘‘branches’’ correspond au fait que la symbolique du parasol coïncide avec celle de l’arbre avec ses branches étalées, le manche de l’un et le tronc de l’autre représentant littéralement l’Axis Mundi. De la même manière le mot chattra correspond à channa comme ‘‘toit’’ (ici, toit du monde) et chaya comme ombre et abri ; le parasol est en fait un toit portable.
[15] La ‘flèche’’ est étymologiquement une ‘‘lance’’ ou ‘‘espar’’ ; en même temps, une référence herméneutique au ‘‘spire’’ de ‘‘spiration’’ serait de mise, puisque c’est précisément avec le ‘‘souffle’’ ou ‘‘inspiration’’ (udāna) que l’on atteint des niveaux de références de plus en plus élevés. Il ne faut pas non plus négliger la signification basique de la « pointe de la flamme ou de la lumière » dans sikhā. La seule mèche de cheveux (sikhā) laissée sur la tête rasée du Brāhmane (comme ‘‘la mèche du scalpe’’ des amérindiens) correspond au mât du thūpa et à la flèche d’une église ; elle indique littéralement la façon dont l’esprit monte à travers le foramen scapulaire lorsque nous ‘‘abandonnons le fantôme’’ ; il représente des extensions d’être au-delà du niveau de référence humain qui se termine par la couronne de la tête. Les différentes formes de coiffes exaltées sont d’une importance similaire. Le sikhara en tant que forme architecturale est construit sur une réduplication des toits (Parmentier, Etudes Asiatiques, II, 1925, pp.229-233), tout comme la série de parasols formant un chatravalli est une série de toits ; l’āmalaka (représenté aux niveaux intermédiaires par des āmalaka en quartiers aux angles, équivalents aux positions du soleil dans les quatre quartiers) est évidemment la plaque de toit d’origine (kaṇṇikā) ou un dôme, ou un ornement correspondant au centre d’un plafond plat, et en tant que tel représente le soleil au zénith le plus glorifié, couvrant ce qui dans un temple en ruine auquel l’āmalaka est tombé devient un foramen visible ; on pourrait même comparer une telle ruine à une trépanation post-mortem telle que connue par l’homme néolithique dans de nombreuses régions du monde. La multiplication des parasols (pour lesquels nous avons une référence textuelle dans Sutta Nipāta, 688, sahassa-maṇḍapalaṃ chattam, où comme d’habitude il faut comprendre qu’ « un millier signifie toutes choses ») correspond à la multiplication des étages supérieurs dont une flèche est constituée.
[16] Avec parinibbhāna dans ce sens, comparons notre mot ‘‘finition’’, dont la référence peut être soit (1) comme la fin ou à la mort d’une opération et/ou (2) comme la perfection de la chose qui a été faite, quand tout a été fait (kataṃ karaṇīyam). La logique d’employer ainsi un mot qui signifie en dernière analyse une dé-spiration ou la mort dépend du fait que tout changement est une mort (Cf. Aṇguttara-Nikāya, II, 82, tato cuto, ‘‘y mourant’’, en ce qui concerne l’abandon d’un métier), et tout développement spirituel se tenant debout sur les tremplins de notre moi mort ; le développement spirituel achevé représenté par le terme bhāvitattā et impliqué dans parinibbuto, étant une mort finale pour toute individualité. Dans ce sens parinibbuto, bien qu’il se réfère communément au décès réel d’un Arhat ou d’un Buddha, peut signifier « être devenu un produit ‘‘fini’’ », sans aucune référence nécessaire à la mort réelle du corps.
[17] « Ce qui est à l’intérieur de l’autel est sa forme délimitée ; ce qui est sans autel est l’espace illimité » (Kauṣītaki Brāhmaṇa, VIII, 5). La représentation dans son ensemble est à ‘‘l’intérieur et à l’extérieur’’, c’est-à-dire immanente et transcendante ; cf. le « tout cela est intérieur et extérieur » de l’Īśā Upaniṣad, 5.
[18] Une justification complète de notre traduction sera faite par ailleurs. Ici, nous dirons seulement que le dictionnaire de la Pāli Text Society, en faisant de vyañjana ‘‘la lettre’’ et d’attha ‘‘l’esprit’’ d’un texte inverse le sens réel de ces termes ; en Pāli vyañjana est anagogie, de même qu’en sanskrit, vyañjana, dans la rhétorique médiévale, est la saveur (rasa) d’un mot par opposition à sa simple dénotation (abhidhā). Dans le présent contexte odhiso dérive de avadhā, ‘‘poser’’, analogue à abhidhā, ‘‘dénoter » ; ajoutons que l’expression peut s’appliquer non seulement au symbole verbal mais encore à tout symbole susceptible d’être appelé dhātu, une chose ‘‘déposée’’, au même sens que abhidhā et odiso, c’est ce qui est immédiatement ‘‘posé’’ dans ce que l’on formule en paroles.
[19] C’est-à-dire au nombril de la terre et au centre de l’univers, d’où procèdent les quatre directions et vers lesquelles elles convergent. Cf. Ṛgveda, X, 5, 6 où Agni se présente comme un Pilier de Vie « à la séparation des voies » et dans Taittirīya Saṃhitā, IV, 2, 5, 5 où la position de Savitṛ est ‘‘à la croisée des chemins.’’
[20] Probablement en référence à l’application des ‘‘marques à cinq doigts’’ telles celles qui sont montrées sur notre bas-relief (et bien d’autres) à la base du thūpa ; voir. Vogel, « The sign of the Spread Hand or ‘five-finger Token’ (pañcaṅgulika) in Pali literature », Verslag, en Mededeel, d, k, Akad, v, Wetenschapen, Afd, Letterkunde, 5, e Reeks, Deel, IV, Amsterdam, 1919. Comme on peut le voir dans notre bas-relief, la base du thūpa est ornée d’une rangée de marques à cinq doigts (pañcaṅgulika-pantika, comme dans le Mahāvaṃsa, XXXII, 4. Des ornements similaires apparaissent sur les représentations des autels à Bhārhut. Celles-ci, comme le dit Vogel (p.222) ne sont pas (sur le bas-relief) des représentations de véritables marques des fidèles, mais des représentations d’ornements qui sont eux-mêmes des marques appliquées par de vrais fidèles, peut-être comme une sorte de signature. Des marques similaires de mains appartiennent à l’antiquité préhistorique, se produisant par exemple en abondance dans les grottes paléolithiques, où leur but est également supposé avoir été ‘‘magique’’.
[21] Abhivādessanti n’est pas simplement ‘‘fera la salutation’’ mais implique en même temps une circumambulation, comme dans Dīgha-Nikāya, I, 125 où Soṇadaṇḍa « salua le Bienheureux et fit une circumambulation autour de lui, quand il fut parti » (bhagavantam abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi).
[22] Cittam pasādessanti (= cittaṃ sappabhāsaṃ bhaveti, Saṃyutta-Nikāya, V, 263) ; pasādati est littéralement ‘‘s’installer’’ et donc ‘‘s’éclaircir’’, comme l’eau boueuse ‘‘s’éclaircit’’ lorsque ses impuretés descendent, ou lorsque le temps s’éclaircit après une tempête. Citta implique à la fois ‘‘penser et vouloir’’ (cf. l’équivalence de ‘‘homme’’ et de kam dans de nombreux contextes, Kāmadeva comme Manobhava, et notre ‘‘avoir un esprit pour’’ dans le sens de ‘‘vouloir’’. Cittam pasādessanti tesaṃ taṃ bhavissati dīgharattam hitāya sukhāya est donc essentiellement identique au « Béni sois-tu si ta pensée et ta volonté peuvent rester immobile » de Jacob Boehme. La parenté des mots pāsāda ayant pour signification ‘‘bâtiment à étages’’ (sécurisé dont on regarde le monde en difficulté) et pāsādika, ‘‘brillant’’ (Lat, claris), et en ce sens ‘beau’’, doit être remarqué.
[23] Le texte a, en fait, en vue quatre de ces ‘‘lieux’’, à savoir les sites de la Nativité, du Grand Eveil, de la Première Promulgation et de la Pleine Extinction.
[24] Sugatim, littéralement ‘‘bien parti’’ (cf. Sugata comme une épithète du Buddha) ou ‘‘parfait’’.
[25] La coïncidence de la visibilité avec la beauté est impliquée dans la désignation habituelle du Soleil comme ‘‘visible’’ (dṛśyantaḥ, Ṛgveda, VIII, 66, 44, paśyataḥ, Jaiminīya Upaniṣad Brahmaṇa, I, 57, 5, etc.). Id quod visum placet n’est pas, bien entendu, en référence à la simple perception physique des surfaces esthétiques, mais à leur ‘‘compréhension’’ et à la manière dont nous disons toujours ‘‘je vois’’ signifiant ‘‘je comprends’’ ; l’objet de placet n’est pas un oculam mais un animan, comme dans Witelo, De Perspectiva, IV, 149 : pulchritudo comprehenditur ex comprehensione formarum visibilium placentium animae. On ne ‘‘voit’’ pas vraiment ce qui est simplement visible, mais ce qui est aussi clair.
[26] Rasa dans les contextes plus anciens est souvent rendu par ‘‘essence’’ (dans le sens d’‘‘extrait’’), mais cela n’est pas satisfaisant pour de nombreuses raisons, et en premier lieu parce que ‘‘essence’’ est nécessaire pour une utilisation dans son sens propre et premier d’‘‘être’’ (esse ou id quod est) ; sattva par exemple, est une essence en tant que esse. Notre rendu de rasa par ‘‘saveur’’ non seulement dans les contextes d’alaṃkāra mais ailleurs, est exactement parallèle à l’idée de ‘‘connaissance par assimilation’’ (conformité ou incorporation) à propos de laquelle, de plus, nous parlons encore de ‘‘digérer’’ une idée. Le lien entre la connaissance et la dégustation est inhérent au mot sapientia ; quasi sapida scientia, seu scientia cum sapore, id est cognition cum amore (Saint Tomas d’Aquin, Somme Théologique, I, 43, 5 et II-II, 45, 2 et 46, 1 avec d’autres références), – cognitio cum amore, étant précisément philosophia ou ‘‘sagesse’’ comme distincte d’une simple observation empirique.
[27] Le Gandhakuṭi original dans le Jetavanārāma est représenté et étiqueté comme tel dans le bas-relief de Bhārhut qui est reproduit par Cunningham, Pl. LVII, où c’est une simple cabane à étage. Le terme a été appliqué par la suite à toute résidence du Buddha, et finalement au temple bouddhiste, également considéré comme la maison du Buddha.
[28] Nous n’avons pas actuellement rencontré l’expression dhammacetiya ghara dans la littérature, et donc nous nous abstenons donc de l’utiliser ci-dessus.