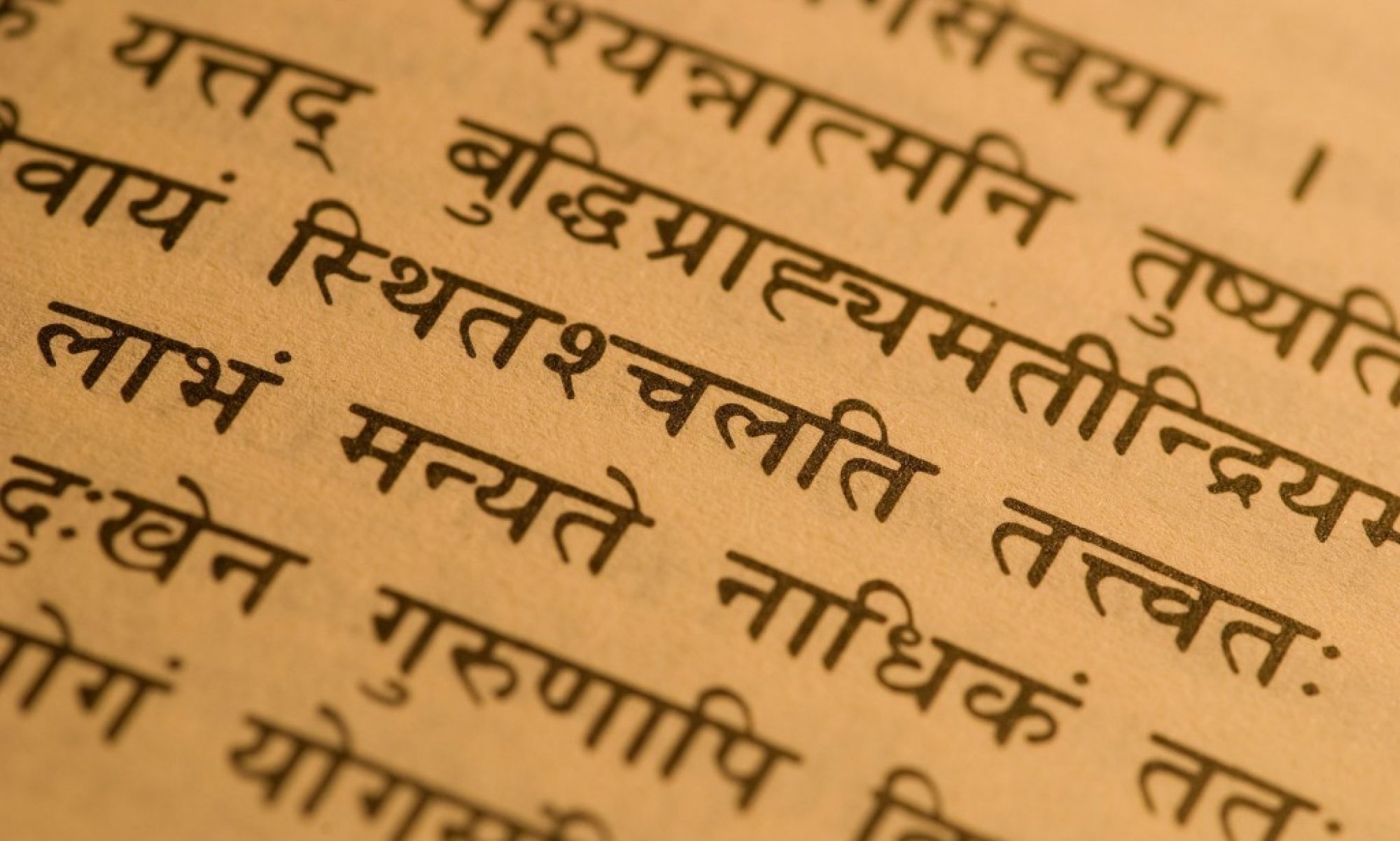Deux passages du Paradis de Dante
(Cet essai a été publié dans Speculum, XI (1936)

Il est maintenant pleinement reconnu, depuis un certain temps, que les analogies islamiques ont une valeur particulière pour la compréhension de La Divine Comédie de Dante, non seulement en ce qui concerne la forme de base du récit[1], mais en ce qui concerne les méthodes par lesquelles les thèses sont communiquées[2]. Et cela serait tout à fait valable en dehors de la considération d’éventuels problèmes d’« influences » qui pourraient être envisagés d’un point de vue plus restreint de l’histoire de la littérature. Il a été justement remarqué par H. A. Wolfson que les « littératures philosophiques médiévales arabes, hébraïques et latines étaient en fait une philosophie exprimée dans différentes langues, traduisibles presque littéralement l’une dans l’autre. »[3] Encore une fois, si cela est vrai, ce n’est pas simplement le résultat d’une proximité et d’une influence, ni d’autre part, d’un développement parallèle, mais parce que « La culture humaine est un tout unifié, et dans les différentes cultures on trouve les dialectes d’une seule langue spirituelle »[4], parce que « une grande ligne universelle de métaphysique est évidente parmi tous les peuples. »[5] Sans aller trop loin dans le temps ou dans l’espace – et on pourrait aller au moins jusqu’aux sumériens et en Chine – il suffira à présent de dire que ce qui est affirmé par Wolfson de l’arabe, de l’hébreux et du latin sera aussi valable pour le sanskrit s’il est ajouté à la liste.
Ces dernières années, j’ai maintes fois attiré l’attention sur les remarquables équivalences doctrinales et même verbales que l’on puisse démontrer entre la littérature traditionnelle latine médiévale et la littérature védique indienne, par rapport à laquelle, si l’emprunt était assumé, la priorité devrait être accordée au côté védique ; mais l’emprunt n’est pas assumé. Comme ces équivalences ne sont probablement pas familières à mes lecteurs actuels, quelques une seront citées ici ; et si frappantes qu’elles soient, ce ne sont que des échantillons d’innombrables autres du même genre.
Nous trouvons qu’il est dit, par exemple, en rapport avec la doctrine orthodoxe des deux naissances du Christ, éternelle et temporelle, que « de la part de l’enfant il n’y a qu’une filiation en réalité, bien qu’il y en ait deux en apparence » (Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, III, 35, 5 ad 3) ; voir., « Sa naissance en l’Esprit de Marie était à Dieu plus agréable que sa nativité dans la chair » (Maître Eckhart, E. Evans, I, 418). Et dans la mesure où la filiation du Christ est de toute façon une « opération virtuelle à partir d’un principe conjoint (a principio conjunctivo ) », et que la « filiation éternelle ne dépend pas d’une mère temporelle » (Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, I, 27, 2c et III, 35, 5 ad2), il s’ensuit que le Christ est materné dans l’éternité pas moins que dans le temps ; la mère dans l’éternité, « l’Esprit de Marie » de Maître Eckhart, étant évidemment « cette nature divine par laquelle le Père engendre » (Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, I, 41, 5c), « Cette nature, à savoir, qui a créé toutes les autres » (Saint Augustin, De trinitate, XIV, 9) – Natura naturans, Creatrix universalis, Deus, dans la mesure où l’essence et la nature ne font qu’un en Lui, dans l’Identité Suprême qui est l’unité des principes conjoints. Enfin, dans la mesure où la vie divine est sans incident, il n’y a évidemment qu’un seul acte de génération, bien qu’il y en ait ici « deux dans l’aspect, ce qui correspond aux deux relations chez les parents, comme considérées par l’intellect » (Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, III, 35, 5, ad.3). C’est donc la doctrine chrétienne latine selon laquelle il y a une génération, mais deux mères logiquement distinctes. L’équivalent exact de ceci, en peu de mots, se produit dans le Gopatha Brāhmaṇa, I, 33, « deux matrices, un acte de génération (dve yonī ekaṃ mithunam) ». Ce texte bref, d’une part résume la doctrine védique familière de la double maternité d’Agni qui est dvimātā – comme, par exemple, dans le Ṛgveda, II et III, 2, 2, « Il devint le fils de deux mères […] il a été animé dans des matrices différentes », et dans le Ṛgveda, I, 113, 1-3, où la Nuit « quand elle a conçu pour la croissance du Soleil, cède la matrice à (sa sœur) l’Aube » – et, d’autre part, au dogme dérivé de la double maternité (ou bien de la maternité et la mère nourricière) par laquelle l’Avatar éternel est manifesté dans le Vishnouisme, le Bouddhisme et le Jaïnisme, où par une formulation quelque peu matérialisée l’enfant divin est effectivement transféré de la matrice du pouvoir spirituel à celui du pouvoir temporel, représenté respectivement par les reines Devānandā et Tisalā[6].
Dans l’Aitareya Brāhmaṇa, III, 43, le modèle du Sacrifice accompli à l’imitation de ce qui a été fait au commencement est décrit comme « sans commencement ni fin […] Ce qui est son commencement est aussi sa fin, ce qui est encore sa fin est aussi son commencement, ils ne distinguent pas ce qui est antérieur et ce qui est postérieur », avec lequel on peut comparer Boèce, Consolation de la Philosophie, I, prose 6, « est-il possible que toi qui connais le commencement de toutes choses ne connaisse pas aussi leur fin ? » ; saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, I, 103, 2c , « la fin d’une chose correspond à son commencement » ; Maître Eckhart (Ed. Evans, I, 224), « le premier commencement est dû à la dernière fin » ; et Dante, Paradis, XXIX, 20, 30, « né prima né poscia […] sanza distinzione in essordire » [« ne procéda ni avant ni après […] sans distinction dans son commencement »]

La définition d’une nature personnelle par opposition à une nature animale dans Aitareya Āraṇyaka, II, 3, 2, à savoir « Une personne (puruṣa) est plus douée de compréhension, elle dit ce qui a été discriminé, elle fait des distinctions, elle connaît le lendemain, elle sait ce qui est et n’est pas mondain, et par le mortel cherche l’immortel », tandis que « quant à l’autre bétail, la leur est une perception valide simplement selon la faim et la soif, ils ne parlent pas de ce qui a été discriminé », etc., ce qui est presque identique à la définition classique de Boèce, Contra Eutychen, II : « Il n’y a pas de personne pour un bœuf ou tout autre animal qui, muet et irrationnel, mène une vie uniquement sensorielle, mais nous disons qu’il y a une personne pour un homme, Dieu ou un ange […] il n’y a aucune personne pour un homme s’il est un animal ou en général. »
« ‘‘CELUI QUI EST’’ est le principe de tous les noms appliqués à Dieu », dit Saint Jean Damascène (De fide orthodoxa, I) ; ainsi dans la Kaṭha Upaniṣad, VI, 13, , « Il doit être appréhendé comme ‘‘IL EST’’. » Quant à la « pensée de Dieu », laquelle « n’est pas atteignable par un argument » (Kaṭha Upaniṣad, II, 9), que « Sienne est cette pensée par qui elle est impensée, et s’il la pense, alors il ne comprend pas » qui correspond à Denys l’Aréopagite (La théologie mystique, I) : « Ce qu’on ne peut pas voir ou savoir, c’est vraiment ce qu’il faut voir et savoir », et Epître ad Caium Mon : « Si quelqu’un qui a vu Dieu a compris ce qu’il a vu, alors il n’a pas vu Dieu lui-même, mais une de ces choses qui sont à Dieu. »
A propos de l’Immaculée Conception, saint Thomas d’Aquin (Somme Théologique, III, 32, 1 ad 1) remarque que tandis que dans ce cas le Spiritus [l’Esprit] est entré dans la forme matérielle, sans moyens, dans la génération normale « la puissance de l’âme, qui est dans le sperme, par l’Esprit qui y est renfermé, façonne le corps. » Cela correspond non seulement à la brève formulation de Ṛgveda, VIII, 3, 24, « L’Esprit est la part du père, le vêtement du corps (ātmā pitus tanūr vāsaḥ) », mais plus explicitement à Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, III, 10, 5, « C’est dans la mesure où le Souffle-de-Vie habite la semence dépensée, celui (qui doit naître) prend forme (yadā hyeva retas siktaṃ prāṇa āviśaty atha tat saṃbhavati) », et dans la Kauṣītaki Upaniṣad, III, 3, « C’est comme Souffle (prāṇa) que le Spiritus [l’Esprit] Intellectuel (prajñātman) saisit et érige le corps. »
Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, I, 45, 1c : « La création, laquelle est l’émanation de tout être, est à partir du non-être, qui n’est rien (Creatio, quae est emanatio totius esse, est ex non ente, quod est nihil) », combiné avec I, 14, 8c : « La connaissance de Dieu est la cause des choses. Car la connaissance de Dieu est à toutes les créatures ce que la connaissance de l’artisan est aux choses faites par son art (sicut scientia artificis se habet ad artificaiata) » et avec la doctrine de l’Esprit comme puissance animatrice dans l’acte de génération, qu’elle soit humaine ou divine (voir ci-dessus) – tout cela est représenté dans une formulation plus brève du Ṛgveda. Ainsi, dans Ṛgveda, X, 72, 2 : « Le Maître du Pouvoir Spirituel comme un forgeron avec son soufflet a soudé toutes ces générations d’Anges ; dans l’éon primordial, l’être a été engendré du non-être », où « Forgeron »[7] (karmāra, « artisan », « ouvrier »), comme Tvaṣṭr (le « Charpentier »[8], qui dans le Ṛgveda (« façonne par l’Intellect », manasā takṣati ), dans le sens de la Scolastique per verbum in intellectu conceptum, prédicat de l’artisan dans la Somme Théologique, I, 45, 6c) et Viśvakarman ( « Créateur de l’univers », plus tard l’aspect protecteur de la divinité par rapport à l’artisanat, et vénéré en tant que tel dans leurs moindres mystères), correspond à Deus sicut artifex dans l’imagerie scolastique ; et « soudé avec son soufflet » (samadhamat) fait allusion au « souffle » de l’Esprit, à la Tempête qui l’anime (vāta, vāyu), par laquelle le Fils lui-même est « évéillé » (Agni, vātajūtaḥ, Ṛgveda, I, 65, 4 ; VI, 6, 3 etc.) et « fait pour flamber » (dhamitam, Ṛgveda, II, 24, 7), « quand Vāta souffle sur sa flamme » (Ṛgveda, IV, 7, 10), « cette Tempête, ton Spiritus [Esprit] tonne à travers l’univers » (ātmā te vātaḥ, etc., Ṛgveda, VII, 87, 2), « Vāyu, la spiration des Anges, dont le son est bien entendu, bien que sa forme ne soit jamais vue » (Ṛgveda, X, 168, 4).
La définition la plus scolastique du péché, quel qu’il soit, est la suivante : « Le péché est un écart par rapport à l’ordre à la fin. » (Somme Théologique, II-I, 21, 1c et 2 ad 2), et à propos du péché artistique, saint Thomas d’Aquin poursuit en expliquant qu’il s’agit d’un péché propre à l’art « si un artiste produit une mauvaise chose, en ayant l’intention de produire quelque chose de bien ; ou produit quelque chose de bien en ayant l’intention de produire quelque chose de mal. » Dans la Kaṭha Upaniṣad, II, I, I, celui qui choisit ce qu’il aime le plus (preyas) plutôt que ce qui est le plus beau (śreyas) est dit « s’écarter de la fin » (hīyate arthāt) ; dans Śatapatha Brāhmaṇa, II, I, 4, 6, si une certaine partie du rite est mal faite, « ce serait un péché » (aparāddhi)[9], comme si l’on faisait une chose en ayant l’intention d’en faire une autre ; ou si l’on devait dire une chose en ayant l’intention d’en dire une autre ; ou si l’on devait aller dans un sens tout en ayant l’intention d’en emprunter un autre. »
Dans la Somme Théologique, I, 103, 5 ad I : « On dit que ses choses sous le soleil sont générées et corrompues selon le mouvement du soleil », et III (Supp) 91, I, ad. I : « L’état de gloire n’est pas sous le soleil. » Dans Śatapatha Brāhmaṇa, III, 3, 3, 7, « Celui qui brille (le Soleil) est cette Mort (un nom essentiel de la divinité ab intra) », en conséquence, toutes les créatures en dessous de Lui sont mortelles, mais celles au-delà de Lui sont des Anges (ou « Dieux ») qui sont vivants ; et X, 5, I, 4, « Tout ce qui vient du Soleil est sous l’emprise de la Mort (mṛtyunāptam). »

On peut également citer une paire d’exemples d’origine plus ancienne du côté européen. Dans l’Évangile de Matthieu, 10, 16, « prudentes sicut serpentes, et simplices sicut columbae » [« Soyez donc prudent comme les serpents, et simples comme les colombes. »], qui correspond au Ṛgveda, X, 63, 4, ahimāyā anāgasaḥ. Encore une fois, alors que dans Genèse, II, 21-22, Dieu « a pris l’une des côtes (d’Adam) […] et de la côte qu’il avait prise de l’homme, Le Seigneur Dieu forma une femme, et il l’amena à l’homme », et III, 20, « Adam donna à sa femme le nom d’Ève, parce qu’elle a été la mère de tous les vivants. », donc aussi dans le Ṛgveda le nom de la fille de Manu est la « Côte » (par śur ha nāma mānavī), qui sous un autre nom, Īḍā, est la mère « par qui il (Manu) a engendré cette race d’hommes » (Śatapatha Brāhmaṇa, I, 8, I, 10), Manu étant dans la tradition hindoue l’archétype et l’ancêtre des hommes au même titre qu’Adam dans la tradition hébraïque, la condition d’inceste dans les deux formulations dépendant du « lien de sang » (jāmitra) des parents d’origine.
Un seul exemple islamique peut être ajouté. Tandis que saint Augustin, Confessions, VII, II, à propos des choses créées, « Un être qu’ils ont, parce qu’ils sont de Toi : et pourtant aucun être, parce que ce que Tu es ils ne le sont pas », et saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, I, 44, 1c, « Tous les êtres en dehors de Dieu ne sont pas leur propre être, mais des êtres par participation », nous trouvons dans Jāmī, Lawā’iḥ XIII, « La terre manque d’Être vrai, mais en dépend – Tu es l’Être vrai. »
Non seulement d’autres parallèles doctrinaux et verbaux de ce genre pourraient être cités presque ad infinitum[10] – par exemple, à propos de sujets tels que l’Exemplarisme[11], la Transsubstantiation et l’Infaillibilité – mais un équivalent similaire pourrait être encore plus facilement démontré dans le domaine du symbolisme visuel[12], qui est un mode de communication plus important que le symbolisme verbal, c’est l’idiome caractéristique de la métaphysique traditionnelle. Par exemple, on a souvent mis en évidence la valence commune de la rose chrétienne et du lotus indien comme représentations du fondement de toute manifestation, support de l’être lorsqu’il procède ou semble procéder de l’être au devenir. Le cas de la forme musicale est le même : « Un exemple de la ténacité avec laquelle la musique d’un culte survit est fourni en Occident par la musique d’église catholique qui, dérivée du chant juif des temples, se démarque de l’art musical tout à fait différent de nos jours, comme un bloc erratique. Il existe des exemples similaires à l’Est, comme ceux des mélodies indiennes du Sāmaveda, et au Japon de chant des drames No, qui même dans l’environnement courtois et profane tardif dans lequel nous l’entendons, a préservé sa signification liturgique originelle. » (Robert Lachmann, Musik des Orients, pp.9-10, Breslau, 1929). C’est, en fait, le cas que même la musique « profane » de l’Inde, où rien, en effet, ne peut être défini comme entièrement séculier, a conservé cette qualité d’infini qui est affirmée dans le chant liturgique dans un passage de l’Aitareya Brāhmaṇa cité ci-dessus et qui est également reconnu dans le plain-chant chrétien.
La formule communément admise de l’existence d’un gouffre séparant l’Europe de l’Asie est donc fallacieuse en ce sens que s’il y a division, la ligne de partage est traçable non pas entre l’Europe et l’Asie considérée normativement, mais entre l’Europe médiévale et l’Asie, d’une part, et l’Europe moderne d’autre part : en général et en principe, tout ce qui est vrai pour l’Europe médiévale le sera aussi pour l’Asie et vice versa.
En ce qui concerne la portée de tous ces parallèles sur la validité de la doctrine et de l’exégèse chrétiennes : d’un point de vue hindou, la conséquence naturelle de cette collation sera d’évoquer la considération : « La doctrine chrétienne, jugée selon les normes védiques, est aussi orthodoxe ». La reconnaissance inverse, que « la doctrine védique jugée par les normes chrétiennes, est également orthodoxe », pourrait être, et a priori devrait être attendue, mais étant donnée l’hypothèse chrétienne non seulement d’une connaissance de la vérité (qui peut être librement accordée) mais aussi une possession exclusive de cette connaissance (comme les hindous ne se revendiquent ni ne l’accordent à autrui), tout ce qui peut être prédit pour le moment est une acceptation des données védiques comme « arguments extrinsèques probables » (Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, I, I, 8 ad2), de même que saint Thomas d’Aquin, en fait, s’est servi d’Aristote, et comme saint Jérôme, en discutant de la vierge sur l’état matrimonial (Adversus Jovinianum, I, 42), invoquait en fait la doctrine de « Gymnosophistes de l’Inde, parmi lesquels le dogme est transmis que Bouddha, le chef de leur enseignement, est né du flanc d’une vierge. »
Pour autant que les comparaisons qui ont été si largement faites entre le christianisme et le bouddhisme (dans lequel saint Jérôme semble avoir été le pionnier, bien que le cas de Josaphat = Bodhisattva doive également être pris en compte), ou le néoplatonisme et le bouddhisme, sont en question, il faut se rappeler que bien que les parallèles soient réels, néanmoins les déductions quant à la dérivation ou à l’influence ne sont pas fondées, dans la mesure où les doctrines bouddhistes sont elles-mêmes dérivées, et les analogies chrétiennes et néoplatoniciennes avec les textes prébouddhiques peuvent être présentées en un plus grand nombre et avec plus de force. Par exemple, tous les détails de la nativité du Bouddha, sans exclure le détail de la naissance du flanc de sa mère, sont, en fait, déjà facile à retrouver dans les nativités védiques d’Indra et d’Agni, respectivement les types des pouvoirs temporels et spirituels, souvent combinés dans le duel Indrāgni, roi-prêtre. Nous maintenons, en d’autres termes, la relative indépendance de la tradition chrétienne à tout moment, que ce soit celle de Denis l’Aréopagite ou celle de Dante, en même temps que nous rapportons tout l’enseignement orthodoxe, dont l’expression védique elle-même n’est qu’une expression tardive à une source commune (comme on peut l’ajouter, bien que ce ne soit pas essentiel à l’argument actuellement restreint) finalement surhumaine. Les problèmes ne sont pas essentiellement, mais seulement accidentellement des problèmes d’histoire littéraire.
On en a assez dit maintenant pour indiquer les principes impliqués, et peut-être pour convaincre le lecteur qu’il n’est peut-être pas déraisonnable de chercher dans les textes sanscrits aussi bien qu’islamiques des parallèles ou même des explications, mais pas nécessairement des sources, d’idiomes particuliers de la pensée employés par Dante, dont aucune des idées n’est nouvelle, bien qu’ils revêtent l’enseignement traditionnel d’une forme vernaculaire d’une splendeur incomparable, splendor veritatis. Les deux passages choisis pour le commentaire sont choisis non plus en raison de leur importance particulière, ni parce qu’ils peuvent être mis en parallèles plus facilement que beaucoup d’autres, mais comme ayant présenté des difficultés particulières aux commentateurs ne s’appuyant que sur des sources européennes.
« Così si fa la pelle bianca nera,
nel primo aspetto della bella figlia
di quel ch’apporta mane e lascia sera. » (Dante, Paradis, XXVII, 136-138)
[« Ainsi la peau blanche devient noire
à l’apparition de la belle fille
de celui qui amène le matin et laisse le soir. » (Trad. Jacqueline Risset)]

Dans la version de P. H. Wicksteed : « Ainsi noircit au premier aspect la peau blanche de sa belle-fille qui apporte le matin et part le soir. » On remarque le premier parallèle chez Eckhart, Ed. Evans, I, 292 : « L’âme, à la poursuite de Dieu, s’absorbe en lui, […] de même que le soleil engloutira et éteindra l’aurore. » ; (Ibid. p.365 : « Expiée avec son Créateur, l’âme a perdu son nom, car elle-même n’existe pas ; Dieu l’a absorbée en lui comme le soleil engloutit l’Aurore jusqu’à ce qu’elle disparaisse »). Le texte du Paradis a été qualifié de « passage difficile et contesté », bien qu’en tout cas c’est bien le Soleil qui au vers 138, « amène le matin et part le soir. » [« Di quel ch’apporta mane e lascia sera »]. Les mots d’Eckhart indiquent déjà que la « fille » doit être l’Aube. Il est vrai que dans la mythologie classique, l’Aube est la sœur plutôt que la fille du Soleil, mais c’est justement ici que la tradition védique sera utile. Car si l’Aube y est parfois la Sœur du Soleil ou du Feu (Ṛgveda, VI, 55, 5 et X, 3, 3), elle est typiquement et constamment la fille, ainsi que la fiancée du Soleil, qu’on appelle son « ravisseur » (jāra). Elle est, en effet, du point de vue hindou, la même que la « Vierge mère, fille de ton fils » (Paradis, XXXIII, 1) de Dante ; la Mère de Dieu, du Christ, par qui « toutes choses ont été faites » (Évangile de Jean, I, 3), « car c’est en lui que toutes choses ont été créées » (Épître de saint Paul aux Colossiens, I, 16), et ainsi la Mère de toutes choses, est une avec Eve, dans le même sens en ce que le Christ est un avec Adam ; c’est, en effet, précisément comme la Magna Mater, die eine Madonna [« La Terre Mère, la seule Madone »] (Jeremias), que Uṣas, l’Aube autrement connue sous le nom de Sūryā (la « déesse » Soleil, comme disincte de Sūrya, le « dieu » Soleil), devient l’épouse du Soleil dans l’infini, Liebesgeschichte des Himmels [« Histoire d’amour du Paradis »] (E. Siecke). Les références védiques sont innombrables à ces événements et surtout à la destruction de l’Aube par son amant, le Soleil, qui la suit dans une chaude poursuite (l’inverse de la formulation d’Eckhart citée plus haut). Dans l’hymne célèbre du Ṛgveda, X, 189, communément employé comme oratio secreta, la Reine Serpent (un autre des noms de l’Aube et de la Terre Mère) est « Celle qui se meut dans les sphères lumineuses, Elle comme sa Voix (vāc, féminin) est donnée au Soleil-Ailé ; quand Il in-spire profondément, alors Elle ex-pire (asya prāṇāt apānatī). »
L’heure glorieuse de l’Aube est très éphémère ; « Une vierge non maîtrisée, Elle sort, se prémunissant du Soleil, du Sacrifice et du Feu » (Ṛgveda, VII, 80, 2), mais à peine le Soleil l’a-t-il rattrapé que Lui et Elle brillent ensemble (Ṛgveda, VII, 81, 2) ; ne brille plus en privé de son propre rayonnement, mais revêtue du Soleil, Elle « brille désormais dans l’œil brillant de son Séducteur » (Ṛgveda, I, 92, 11). C’est souvent d’Indra comme Soleil dont on parle dans « abattre le char de l’Aube » (Ṛgveda, X, 73, 6), qui devient ainsi Indrāṇī la Reine du Ciel, mais sans distinction de Roi et de Reine.
Il s’agit par ailleurs d’une purification, car avant sa possession, l’Aube a été un « serpent sans pied »[13], ophidien plutôt qu’angélique, la Nuit étant apparentée à sa sœur l’Aube comme Lilith à Eve. C’est précisément à cette nature ophidienne qu’Elle meurt lorsqu’Elle procède, son Assomption succédant alors à son Ascension. Tirée à travers le moyeu de la Roue solaire , en tant qu’Apālā (« Non gardée » dans le sens de « non mariée ») elle reçoit une peau ensoleillée à la place de son ancienne peau de serpent (Ṛgveda, VII, 91), et rendue « apte à être caressée » (saṃśliṣyataḥ ; Śātyāyana Brāhmaṇa cité par Sāyaṇa). Là, le Ciel et la Terre sont embrassés (saṃśliṣyataḥ, Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, I, 5)[14] – ce qui n’est pas un « mythe » dans l’incompréhension anthropologique actuelle du mot, mais une union (mithuna) à réaliser « dans le vide du cœur » (hṛdayākāṣa) par Celui-qui-comprend (saṃvit) et est la « béatitude suprême » (paramo hy eṣa ānandaḥ, Śatapatha Brāhmaṇa, X, 5, 2, 11), le piacere eterno de Dante (Paradis, XVIII, 16) [« tant que le plaisir éternel, qui rayonnait »].
Et tout cela est significatif du point de vue de l’interprétation de notre texte de Dante, car il a été suggéré que la bella figlia [« La belle fille »] du Soleil est l’Humanité, le Soleil étant « le Père de toute vie mortelle » (Paradis, XXII, 116) et l’homme « est engendré par l’homme et le Soleil » (Voir. De la monarchie, I, 9 et 6-7). Il n’y a pas d’antinomie ici, car, comme nous l’avons vu, l’Aube et la Terre Mère, au même sens qu’Adam et Eve – c’est-à-dire d’un point de vue séminal – sont tous des hommes, Tout-le-monde[15], et Tout-le-monde est l’Église, l’Épouse du Christ. Pour être unie à Lui, l’Humanité, l’Église doit être transformée – en langage védique doit se dépouiller de sa peau de serpent et s’éloigner du mal. C’est exactement ce qui est décrit non seulement dans l’histoire d’Apālā, mais encore dans celle du mariage de Sūryā (Ṛgveda, X, 85, 28-33), où la Mariée se détache de sa forme , kṛtyā (« potentielle »), maléfique et peu glorieuse, et dans une ressemblance la plus heureuses (sumaṇgalī) (« la plus belle de toutes les formes justes », comme le Sāṭyāyana Brāhmaṇa décrit Apālā autrefois reptilienne) « assume son Seigneur comme une Épouse » (ā jāyā viśate partim, Ṛgveda, X, 85, 29). Et ceci est encore dit, de la même façon, par saint Bonaventure des noces du Christ avec son Église : « Le Christ présentera son épouse, qu’il aimait dans sa bassesse et toute sa souillure, glorieuse de sa propre gloire, sans tache ou ride « Dominica prima post octavum epiphaniae, II, 2).
Nous avons présenté la tradition de l’Aube à partir de quelques détails, ceci afin de rappeler au lecteur à quel point il est dangereux, lorsqu’elle est en relation avec des écrivains de cette importance et les préoccupations telles que celles de Dante et d’Eckhart qui n’appartiennent pas aux belles lettres[16], bien que chacun soit le « père » d’une langue, d’attribuer à l’invention poétique individuelle ou à l’art, ce que sont réellement des formules et des symboles techniques aux connotations connues. Tout au moins, nos citations védiques suffisent à donner un sens cohérent aux paroles de Dante et d’Eckhart. Les deux sont toujours conscients de bien plus qu’ils ne disent ; comme Dante lui-même qui prévient le lecteur, « mirate la dottrina, che’s asconde sotto il velame degli versi strani » [« voyez la doctrine qui se cache sous le voile des vers étranges »] (L’Enfer, IX, 61). Il faut aussi se rappeler que l’illustration de la doctrine chrétienne au moyen de symboles païens était non seulement du point de vue médiéval tout à fait légitime, mais à même persisté dans la permission d’une pratique jusqu’à des temps relativement modernes, dont un exemple peut être cité dans l’œuvre de Calderón[17]. Il n’est donc pas déraisonnable de supposer qu’Eckhart et Dante connaissaient tous deux les doctrines traditionnelles – peut-être initiatiques et seulement transmises oralement, ou peut-être seulement pas encore reconstituées dans les documents existants – telles qu’elles ont été citées ci-dessus à propos de il somma sol et de bella figlia.

Notre deuxième passage concerne Paradis, XVIII, 110-111 :
« […] da lui si rammenta
quella virtu ch’è forma per li nidi. »
[« […] de lui se souvient
la vertu qui forme les nids. » (Trad. Jacqueline Risset)
Dans la version de Wicksteed, ne donnant que l’essentiel, nous avons : « de Lui vient à l’esprit cette puissance qui est forme jusqu’aux nids. » Il n’est pas nécessaire de souligner que « forme » doit être pris ici, dans sa signification scolastique habituelle, au sens d’exemplaire, d’être « une forme essentielle » (comme lorsque l’on dit que « l’âme est la forme du corps ») et non au sens vernaculaire moderne de « forme actuelle » ou forme. Maintenant, mis à part les parallèles cités ci-dessous, on peut remarquer que les nids impliquent des oiseaux et que les deux impliquent des arbres, et que les « oiseaux » sont traditionnellement une désignation des Anges, ou de substances intellectuelles, les ailes dénotant une indépendance de mouvement local, et le « langage des oiseaux » est celui de la « communication angélique »[18], où « oiseaux » d’une manière plus générale, peut représenter le vif (dans tous les sens du terme) comme distinct de l’inanimé et de l’immobile. De ce point de vue, qui est en fait le bon, les « nids » seront les demeures des Anges et des autres êtres vivants parmi les branches de l’Arbre de Vie, « nid » signifiera le phénoménal – corporel ou autrement approprié individuellement – l’environnement de l’âme, et le « pouvoir qui est forme jusqu’aux nids » sera Celui qui a fait l’homme à son image et à sa ressemblance. Néanmoins, le passage a été regardé comme obscur ; les commentaires effectués par Wicksteed et Oelsner[19], qui demandent, « Mais pourquoi des nids ? Les nids sont-ils les cieux, nichés les uns dans les autres ? » etc., sont particulièrement sournois, peut-être parce qu’en discutant du M de Jupiter dans Paradis, XVIII, 94-96 [« Puis dans le M du cinquième vocable, elles restèrent ordonnées, si bien que Jupiter y paraissait argent incrusté d’or. »] bien qu’ils reconnaissent que la ressemblance avec un oiseau est voulue, ils ne réalisent pas que ce qui est signifié ici c’est précisément à la ressemblance d’un aigle – c’est-à-dire à la ressemblance de Dieu lui-même, ici « exemplifié » par Jupiter – et par conséquent ne voient pas que les « nids » sont ceux des êtres en cette même image.
Tout ce qui a été dit plus haut est explicite dans la tradition védique, où, d’ailleurs, des deux mots pour « nid », nīḍa et kulāya, le premier rappelle d’emblée le nidi [nid] de Dante. La signification générale de « nid » est définie dans Pañcaviṃśa Brāhmaṇa, XIX, 15, 1 : « Le nid est la progéniture, le nid est le bétail (« grandes possessions », « potentiel réalisé »), le nid est une demeure. » Dans Ṛgveda, I, 164, 20-22, apparaît l’image de deux Aigles qui occupent fraternellement l’Arbre de Vie et l’aspect duel de la Divinité, qui d’une part voit toutes choses[20] et d’autre part mange la figue[21] ; et l’image des autres perchés en bas, « qui chantent les yeux toujours ouverts leur tranche de vie[22] (amṛtasya bhāgam animeṣam […] abhi svaranti), goûtent le miel, et engendrent leurs enfants », mais dont « aucun ne peut atteindre le sommet de l’Arbre sans connaître le Père, le Grand Berger de l’Univers »[23]. Mais dans la mesure où Il est un Contemplatif (dhīraḥ) il a aussi « fait sa demeure en moi qui suis prêt ici (mā dhīraḥ pākam atrāviveśa) », on le trouve ailleurs évoqué non seulement comme « sans nid »[24] (anīḍaḥ, Ṛgveda, X, 55, 5 ; Śvetāsvatara Upaniṣad, V, 14), mais aussi comme le Cygne (haṃsa) qui par les Souffles de Vie protège son « nid en bas » (avaraṃ kulāyam, Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, IV, 3, 12 [« Laissant en bas le nid à la garde du Souffle »]), dont le « perchoir est comme celui d’un oiseau » (sadanaṃ yathā veḥ, Ṛgveda, III, 54, 5-6) : « sans nid » et « niché » correspondent à la nature de la Divinité qui est « Une comme si elle était là-bas » et aussi « multiplement présente dans ses enfants » (Śatapatha Brāhmaṇa, X, 5, 2, 16-17), d’où il est nommé qu’il est Nṛṣad « Assis dans l’homme », Nṛcakṣus « Ayant du respect pour l’homme » et Vaiśvānara, « Commun à tous les hommes »[25].

Les « nids en bas », cependant, ne sont pas simplement ceux des substances individuelles dans le sens expliqué ci-dessus, mais en même temps tout autel sacrificiel, qu’il soit concret ou en vous[26], sur lequel le Feu sacré est allumé, et c’est en ce sens que « la Divinité, abandonnant son trône d’or, se hâte vers la maison natale apparente du Faucon, le siège forgé par la spéculation » (śyeno na yoniṃ sadanaṃ dhiyā kṛtaṃ hiraṇyayam āsadaṃ deva aṣati, Ṛgveda, IX, 71, 6), où le Faucon, est comme d’habitude, le Feu ; le lieu de naissance, comme d’habitude l’Autel ; le giron de la Terre Mère, la matrice de la Mère ; et l’aspect de la Divinité (deva) appelé hâte est celui de Soma, sève de l’Arbre de Vie, le « Vin » de la vie, et le Sacrifice volontaire (krīḷuḥ)[27]. Nous trouvons en conséquence un symbolisme élaboré de l’Autel, qui est le « trône inférieur » de la Divinité, avec cette ressemblance à un nid d’oiseau, et de même que l’Autel est complété de manière à être manifestement comme un nid, comme, par exemple, dans Aitareya Brāhmaṇa, I, 28, où le Prêtre, invoquant « le Feu sacré et l’Hostie Angélique est invité à s’asseoir d’abord dans la maison natale riche en laine » (représenté par le « jonc », ces mots étant tirés de Ṛgveda, VI, 15-16), procède avec la formule « Faire un nid oint pour Savitṛ » (le Soleil comme le « Plus rapide ») et, en fait, prépare « comme si c’était un nid avec des bâtons enveloppants de bois de pītudāru, de bdellium, de touffes de laine et d’herbes parfumées », et tout cela est bien une représentation du nid du Phénix, dans lequel la vie de l’Aigle, le Feu, est perpétuellement renouvelée.
Il ne reste plus qu’à ajouter ce qui est déjà impliqué dans les mots « par spéculation forgée » (dhiyā kṛtam, cité ci-dessus, dhī- en sanskrit védique étant utilisé comme synonyme de dhyāna = contemplatio ), que l’embrasement d’Agni dans ses nids en bas, où jusqu’à ce qu’Il soit allumé, est simplement latent – en d’autres termes, la naissance de Dieu qui d’autre part demeure inconnue – alors qu’il est effectué symboliquement dans le rituel du Sacrifice ou de la Messe, est effectué par « Celui-qui-le-comprend (ya evaṃ vidvān) », « Celui-qui-comprend celui-ci (evaṃvit), le Gnostique (jñānin), « dans l’espace vide du cœur (hṛdayākāśe) », « dans la chambre nue de l’homme intérieur (antar-bhūtasya) », c’est une obscurité intérieure qui est illuminée. « Aucun homme par les œuvres ou les sacrifices n’atteint celui qui vivifie pour toujours » (Ṛgveda, VIII, 70, 3), mais seulement ceux en qui une dernière mort de l’âme a été effectuée et qui, lorsqu’ils se tiennent devant les portes du ciel et font face à la question : « Qui es-tu ? » sont qualifiés pour répondre non pas avec un nom personnel ou de famille, mais avec les mots, « Ce qui que je suis est la Lumière, Toi-même » – seulement ceux-ci sont accueillis avec la bénédiction, « Qui tu es, que je suis, et Qui je suis, Tu es Cela : procède » (Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, III, 14), il ne reste donc rien de l’individu, que ce soit quant au « nom » ou à la « ressemblance » (nāma-rūpa), mais seulement cette Spiration (ātman) qui semblait bien avoir été déterminée, et participée, est en fait indivisible[28]. On se nourrit ainsi en entrant au milieu du Soleil (« Je suis la Voie […] nul ne vient au Père que par moi », Évangile de Jean, 14, 6 ; « Ce n’est qu’en Le connaissant que l’on passe au-delà de la mort, il n’y a pas d’autre Chemin pour y aller » (Vājasaneyi Saṃhitā, XXXI, 18), « la porte par laquelle toutes choses retournent parfaitement libres à leur suprême félicité » (Maître Eckhart, Ed. Evans, I, 400), devient « Celui-qui-se-meut-à-volonté » (kāmacārin) dont la volonté, en effet, n’est plus la sienne, mais confondue avec celle de Dieu. « C’est sa forme propre, qui est sa volonté[29], l’Esprit est sa volonté, il n’a ni volonté, ni désir. » (Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad, IV, 3, 21) ; « il va de haut en bas de ces mondes, mangeant ce qu’il veut, et assumant la ressemblance il veut » (Taittirīya Upaniṣad, III, 10, 5) ; de même dans l’Évangile de Jean, 10, 9 : « Je suis la porte : si quelqu’un entre par Moi, il sera sauvé ; il entrera, et il sortira, et il trouvera des pâturages », et plus explicitement encore dans la Pistis Sophia [« Foi et Sagesse », traité gnostique]
Nous avons esquissé ci-dessus un aperçu sommaire des implications du symbole du « nid » dans la tradition gnostique védique. Il est vrai que l’usage du mot chez Dante aurait dû être compris soit à partir d’autres passages (par exemple, Paradis, XXIII, 1-12, où Béatrice elle-même est comparée à un oiseau qui sort de son nid à l’aube pour saluer le soleil), ou en le comparant avec d’autres textes bibliques tels que l’Évangile de Matthieu, 7, 20 cité en note de bas de page ci-dessus ; mais en même temps, et tout comme à propos du Soleil, on peut tenir pour acquis que Dante, dont la connaissance du symbolisme chrétien et païen est si étendue et si précise[30], était plus que conscient de toutes les significations techniques des symboles qu’il emploie – « techniques », parce que de tels termes ne sont ni employés à titre d’ornement, ni explicables à volonté, mais appartiennent au vocabulaire d’un langage parabolique[31] cohérent. Nous pensons qu’il a été démontré que les références d’un représentant des principes chrétiens orthodoxes, écrivant à la fin et, pour ainsi dire, résumant toute la doctrine du Moyen Âge, peuvent en fait être clarifiées par une comparaison avec ces écritures qui étaient courantes à l’autre bout du monde trois millénaires plus tôt ; et que cela ne peut s’expliquer qu’en supposant que toutes ces « formulations alternatives d’une doctrine commune (dharma-paryāya) » sont des « dialectes du seul et unique langage de l’Esprit », les branches d’une seule et même « tradition universelle et unanime », sanātana dharma, Philosophia Perennis, la « Sagesse incréée, la même maintenant comme elle a toujours été et comme elle sera toujours » de saint Augustin (Confessions, IX, 10).
[1] Voir. Miguel Asín y Palacios, La Escatología musulmana en la Divina Comedia (Madrid, 1919), et la traduction abrégée de H. Sunderland, Islam and the Divine Comedy (Londres, 1926).
[2] Luigi Valli, Il Languaggio segreto di Dante e dei ‘‘Fedeli d’Amore’’ (Rome, 1928) ; René Guénon, L’Ésotérisme de Dante (Paris, 1925) : idem, « Le Langage secret de Dante et des ‘‘Fidèles d’Amour’’ » et « ‘‘Fidèles d’Amour’’ et ‘‘Cours d’Amour’’ », Le Voile d’Isis, XXXVII (1932), et XXXVIII (1933). Des comparaisons indiennes et zoroastriennes ont été faites dans Angelo de Gubernatis, « Dante e l’India », Giornale della Società Asiatica Italiana, III, (1889), et « Le Type indien de Lucifer chez Dante », Actes du Xème Congrès des Orientalistes ; et J. J. Modi, Dante Papers : Viraf, Adamnan, and Dante, and Other Papers (Londres, 1914). De nombreux problèmes sont liés à l’histoire des Templiers et des Rosicruciens.
[3] The Philosophy of Spinoza, I, 10. Cambridge, Mass. (1934).
[4] Alfred Jeremias, Handbuch der altorientalischen Geisteskultur, p. X. (Berlin, 1929).
[5] J. Sauter, « Die altchinesische Metaphysik und ihre Verbundenheit mit der adendländischen », Archiv für Rechts- und Sozial-philosophie, XXVIII, 90, (1934).
[6] Pour de plus amples parallèles, voir. Ananda K. Coomaraswamy, « The ‘‘Conqueror’s Life’’ in Jaina Painting », JISOA, III, 132, (1935).
[7] Cette image du Maître Forgeron avec son soufflet illustre admirablement : « Les vérités spirituelles sont convenablement enseignées à la ressemblance des choses matérielles. » (Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, I, I, 9c).
[8] Ce n’est nullement sans de bonnes et suffisantes raisons que Jésus fut appelé le « Fils du charpentier », car, en effet, il existe un « bois » dont le monde est façonné par le Maître Charpentier.
[9] Aparāddhi dérive de aparādh, qui est défini par Monier-Williams comme « rater son but ».
[10] Les parallèles isolés pourraient être appelés « coïncidences », qui consistent simplement à substituer la description à l’explication. Si pourtant l’on croit avec saint Augustin (De diversis quastionibus, LXXXIII, 24) que « Rien au monde n’arrive par hasard » (une proposition avec laquelle le scientifique polémiquera à peine [ni le théologien, pour qui « si Dieu ne gouvernait pas par des causes médiates, le monde serait privé de la perfection de la causalité », saint Thomas d’Aquin]), trois explications, et seulement trois, de « coïncidences » répétées et exactes sont possibles : il doit y avoir eu (1) un emprunt de la part de la source postérieure, (2) un développement parallèle, ou (3) une dérivation à partir d’une source antérieure commune.
[11] Voir. Ananda K. Coomaraswamy, « L’Exemplarisme védique ». Trad. Fr. Aspects de l’Hindouisme.
[12] Voir. J. Baltrusaitis, Art sumérien, art romain (Paris. 1934), et Ananda K. Coomaraswamy, « The Tree of Jesse and Oriental Parallels », Parnassus, VII (1935).
[13] Pour une présentation plus détaillée, voir. Ananda K. Coomaraswamy, « La face obscure de l’aurore ». Trad. Fr. La doctrine du Sacrifice.
[14] C’est dans le sens de William Blake « Le Mariage du Ciel et de l’Enfer », toutes les propriétés terrestres par lesquelles l’individuation est déterminée étant des « enfers » comme il est explicite dans Jaminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, IV, 26, voir. Saṃyutta-Nikāya, X, 5.
[15] On n’oubliera pas que du point de vue de la scolastique, l’Humanité est une forme qui n’a rien à voir avec le temps ; non pas l’humanité de « l’humanisme », mais un principe créateur informant tout homme, et selon lequel il doit être jugé. Ainsi, Thierry de Chartres parle de la forma humanitatis [« Forme d’humanité »] laquelle nunquam perit [« Ne meurt jamais »], et saint Thomas d’Aquin dit que « humanité est pris pour signifier la partie formelle de l’homme » (Somme Théologique, I, 3, 3). [« Dieu a assumé la virilité et non l’homme » (Maître Eckhart, Ed. Pfeiffer, p.250).
[16] Eckhart, « Tout le bonheur à ceux qui ont écouté ce sermon. S’il n’y avait eu personne ici, j’aurais dû le prêcher à la sébile. » ; « travailler comme si personne n’existait, personne ne vivait, personne n’était jamais venu sur terre » (Ed. Evans, I, p.143 et p.308). Dante « Tout le travail a été entrepris non pas dans un but spéculatif mais à une fin pratique […] la finalité de l’ensemble et de cette partie (Paradis) est d’éloigner ceux qui vivent en cette vie dans l’état de misère et de les conduire à l’état de béatitude » (Épître à Cangrande, 15, 16) ; Bhagavad Gītā, II, 47 : « Tu es commis à agir, mais non à jouir du fruit de tes actes. Ne prends jamais pour motif le fruit de ton action ; n’aie pas d’attachement (non plus) pour le non-agir », et III, 9 : « A l’exception des œuvres accomplies pour un but sacrificiel, l’action est à qui enchaîne en ce monde. Ô fils de Kuntī, pour ce but, libre de tout attachement, acquitte-toi de tes œuvres. »
[17] Voir. René Allar, « Calderón et l’unité des traditions », Le Voile d’Isis, XL, p.404ff. (1935).
[18] Ṛgveda, VI, 9, 5, « L’Intellect est le plus rapide des oiseaux ». Voir. René Guénon, « La langue des oiseaux », Le Voile d’Isis, XXXVI, p.661ff. (1931).
[19] Paradiso, p.227. Temple Classics Edition.
[20] Le Soleil est l’œil de Varuṇa, avec lequel Il surveille tout l’univers (Ṛgveda, passim) ; personne ne peut même cligner des yeux à Son insu (Ṛgveda VII, 86, 6) ; Il compte les clignements des yeux des hommes et sait tout ce que l’homme fait, pense ou imagine (Atharva Veda, IV, 16, 2, 5) laquelle connaissance de Sa part est spéculative (viśvaṃ sa vedo varuṇo yathā dhiyā, Ṛgveda, X, 2, 1). Voir l’Évangile de Luc 12, 6-7 : « Cinq passereaux ne se vendent-ils pas deux as ? Et pas un d’entre eux n’est en oubli devant Dieu. Mais les cheveux mêmes de votre tête sont tous comptés » ; Épitre aux Hébreux 4, 12-13 : « Car elle est vivante la parole de Dieu ; elle est efficace, plus acérée qu’aucune épée à deux tranchants ; si pénétrante qu’elle va jusqu’à séparer l’âme et l’esprit, les jointures et les moelles ; elle démêle les sentiments et les pensées du cœur. Aussi nulle créature n’est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte » ; saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, I, 14, 16c et ad 2, « Dieu n’a de Lui-même qu’une connaissance spéculative […] (dans laquelle) Il possède une connaissance à la fois spéculative et pratique de toutes les autres choses. »
[21] Évangile de Luc 7, 34 : « Le Fils de l’homme est venu mangeant et buvant » ; Deutéronome 4, 24 : « Dieu est un feu dévorant. » Agni le Destrier Céleste, l’Esprit, le Soleil Ailé « Qui d’ici-bas s’envola vers le Ciel […] est le plus gourmand des mangeurs » (Ṛgveda I, 163, 6-7). La « nourriture » de Dieu est notre Vie, car ainsi l’Esprit se revêt de chair, devenant anna-maya.
[22] Voir aussi Ṛgveda VIII, 21, 5 « Assis comme des oiseaux, Ô Indra, nous élevons nos chants vers Toi » ; voir Paradis XVIII, 76-77 : « Ainsi dans les lumières de saintes créatures chantaient en voletant ».
[23] Voir. Paradis, X, 74 : « qui n’a pas d’ailes pour y voler », pour lequel de nombreux parallèles sanskrits pourraient être évoqués – par exemple Pañchaviṃśa Brāhmaṇa XIV, I, 13, « Ceux qui montent au sommet du Grand Arbre, comment s’en sortent-ils ensuite ? Ceux qui ont des ailes s’envolent, ceux qui n’ont pas d’ailes tombent », et de même dans Jaiminīya Upaniṣad Brāhmaṇa, III, 13, 9.
[24] Évangile de Matthieu 8, 20 : « les oiseaux du ciel ont leurs nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête ».
[25] Voir. Ananda K. Coomaraswamy, « L’Exemplarisme védique ». Trad. Fr. Aspects de l’Hindouisme.
[26] Sur l’embrasement d’Agni « en vous », voir. Śatapatha Brāhmaṇa, VII, 4, I, I et X, 5, 3, 3.
[27] Partagé par voie de transsubstantiation : « Les hommes s’imaginent que lorsque la plante est pressée, ils boivent le même Soma, mais de Lui ce que les brahmanes entendent par Soma, nul ne le goûte qui habite sur la terre » (Ṛgveda X, 85, 3-4). « Le Nyagrodha est paraboliquement le roi Soma ; paraboliquement, le pouvoir temporel obtient l’apparence du pouvoir spirituel, au moyen du prêtre, de l’initiation et de l’invocation pour ainsi dire. » (Aitareya Brāhmaṇa, VII, 31). La seule approche de Lui ce fait par le biais de l’initiation et de l’ardeur (Śatapatha Brāhmaṇa III, 6, 2, 10-11) ; voir. Genèse 3, 22 : « qu’il n’avance pas sa main, qu’il ne prenne pas aussi de l’arbre de vie, pour en manger et vivre éternellement ».
[28] « L’âme exigeante ne peut reposer son entendement sur rien qui porte un nom. Elle s’échappe de tout nom dans le rien sans nom […] Ce sont les bienheureux morts […] enterrés et béatifiés dans la Déité […] En cet état nous sommes aussi libres que lorsque nous ne l’étions pas ; libres comme la Déité dans sa non-existence. » (Maître Eckhart. Ed. Evans, I, p.373, 381-382). « Je voudrais descendre jusqu’à l’Annihilation et la Mort Éternelle, de peur que le Jugement Dernier ne vienne et me trouve dans la non Annihilation, et que je sois saisi et remis entre les mains de mon propre Soi. » (William Blake)
[29] Voir. Paradis, XXII, 64-65 : « Ivi è perfetta, matura ed intera ciascuna disianza » [« Là tout désir est parfait, mûr et entier »]
[30] Voir, par exemple, la description technique métaphysique des Trois Mondes dans Paradis XXIX, 28-36,
[« ainsi le triforme effet de son seigneur rayonna tout entier dans mon être sans distinction dans son commencement. Avec les substances furent concréées l’ordre et la construction, et les cimes du monde furent celles d’un acte pur avait produites ; la pure puissance eut la partie la plus basse ; au milieu un lien qui ne se défait pas serra la puissance avec l’acte. » Trad. Jacqueline Risset] et le traitement de il punto dans XIII, 11-13 : « in punta dello stelo, a cui la prima rota va dintorno) [« qui commence à la pointe de l’axe autour de qui tourne la roue »], « en contemplant le point auquel tous les temps sont présents » (XVII, 17-18) « Da quel punto depende il cielo, e tutta la natura » [« de ce point dépend le ciel de toute nature »] (XXVIII, 41-42) pour lesquels on pourrait faire des parallèles indiens, correspondant, par exemple, à Ṛgveda I, 35, 6 āṇiṃ na rathyam amṛtā adhi tasthuḥ.
[31] Clément d’Alexandrie : « La prophéties n’emploie pas de formes figurées dans les expressions pour la beauté de la diction » (Miscellanies VI, 15) ; « Alors que dans toute autre science les choses sont signifiées par des mots, cette science a la propriété que les choses signifiées par les mots ont-elles-mêmes une signification. » (Saint Thomas d’Aquin, Somme Théologique, I, I, 10c). Émile Mâle a judicieusement qualifié le langage du symbolisme chrétien de calculus [« calcul »].